Ex: http://www.counter-currents.com
1. Introduction
Those on the New Right are bound together partly by shared intellectual interests. Ranking very high indeed on any list of those interests would be the works of Martin Heidegger and those of the Traditionalist [1] [2] school, especially René Guénon and Julius Evola. My own work has been heavily influenced by both Heidegger and Traditionalism. Indeed, my first published essay (“Knowing the Gods [3]”) was strongly Heideggerian, and appeared in the flagship issue of Tyr [4], a journal that describes itself as “radical traditionalist,” and that I co-founded. This is just one example; many of my essays have been influenced by both schools of thought.
In my work, I have made the assumption that Heidegger’s philosophy and Traditionalism are compatible. This assumption is shared by many others on the Right, to the point that it is sometimes tacitly believed that Heidegger was some kind of Traditionalist, or that Heidegger and the Traditionalists had common values and, perhaps, a common project. These assumptions have never really been challenged, and it is high time to do so. The present essay puts into question the Heidegger-Traditionalism relationship.
Doing so will allow us to accomplish three things, at least:
(a) Arrive at a better understanding of Heidegger. This is vital, for my own study of Heidegger (in which I have been engaged, off and on, for over thirty years) has convinced me that he is not only the essential philosopher for the New Right, he is the only great philosopher of the last hundred years — and quite possibly the greatest philosopher who ever lived. I don’t make such claims lightly, and feel that I have only recently come to truly appreciate how much we need Heidegger. Yet reading Heidegger is extremely difficult. The present essay will help to clarify his thought by putting it into dialogue with the Traditionalists, whose writings are much more accessible, and much more familiar to my readers.

(b) Arrive at a better understanding of Traditionalism. We will find that in important ways Heidegger’s thought is not compatible with Traditionalism. The reason for this is that from a Heideggerian perspective Traditionalism is fundamentally flawed: it is thoroughly (and naïvely) invested in the Western metaphysical tradition which, according to Heidegger, sets the stage for modernity. In other words, because Traditionalism uncritically accepts the validity of Western metaphysical categories, it buys into some of the foundational assumptions of modernity. In the end, Traditionalism has to be judged a thoroughly modern movement, an outgrowth of the very epoch reviled by the Traditionalists themselves. All this, again, becomes clear only if we view Traditionalism, and Western intellectual history, from a Heideggerian perspective. I will argue that that perspective is correct. Thus, part of the purpose of this essay is to convince those on the Right that they need to take a more critical approach to Traditionalism.
(c) Arrive at a new philosophical approach. Although I will argue that Heidegger and Traditionalism are not compatible, the case can nonetheless be made that Heidegger is a traditionalist of sorts, and that, for Heidegger, something like a “primordial tradition” does indeed exist (though it is markedly different from the conceptions of Guénon and Evola). In short, through an engagement with Heidegger’s thought, and how it would respond to Traditionalism, we can arrive at a more adequate traditionalist perspective — one that shares a great many of the values and beliefs of Guénon and Evola, while placing these on a surer philosophical footing. In turn, I will also show that there are limits to Heidegger’s own approach, and that it is flawed in certain ways. Here we achieve a perfect symmetry, for these flaws are perceptible from a traditionalist perspective, broadly speaking. What I will have to say on this latter topic will also be of great interest to anyone influenced by Ásatrú, or the Germanic pagan revivalist movement.
In the end, we will not arrive simply at a fusion of Heidegger and Traditionalism, since both are transformed through the dialogue into which I put them. We will arrive instead at a new philosophical perspective, a new beginning and a new “program” for Western philosophy, one that has rejected Western metaphysics and that seeks to prepare the way for something yet to come, something beyond the modern and the “post-modern.” This new beginning is possible because the groundwork was laid by Heidegger, Guénon, and Evola (to name only three).
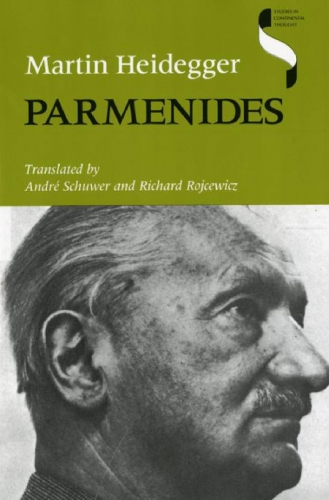
The project described above is quite ambitious, and it cannot be carried out in a single essay. Thus, the present text is the first in a series of several projected essays. (The outline of the series is presented as an Appendix, at the end of this essay.) Here, I will limit myself to a basic survey of Heidegger in relation to Traditionalism, his knowledge of Traditionalist writings, and the criticisms he would likely have leveled against this school of thought.
2. Anti-Modernism in Heidegger and the Traditionalists
The primary reason Heidegger gets associated with Guénon and Evola is that all three were trenchant critics of modernity. Heidegger and the Traditionalists hold that modernity is a period of decline, that it is a falling away from an “originary” [2] [5] position that was qualitatively different, and immeasurably superior. Further, the terms in which these authors critique modernity are often remarkably similar.
Consider these lines from Heidegger’s Introduction to Metaphysics, worth quoting at length because they sound like they could have come straight out of Guénon’s The Reign of Quantity and Signs of the Times:
When the farthest corner of the globe has been conquered technologically and can be exploited economically; when any incident you like, at any time you like, becomes accessible as fast as you like; when you can simultaneously “experience” an assassination attempt against a king in France and a symphony concert in Tokyo; when time is nothing but speed, instantaneity, and simultaneity, and time as history has vanished from all Dasein of all peoples; when a boxer counts as the great man of a people; when the tallies of millions at mass meetings are a triumph; then, yes then, there still looms like a specter over all this uproar the question: what for? — where to? — and what then? The spiritual decline of the earth has progressed so far that peoples are in danger of losing their last spiritual strength, the strength that makes it possible even to see the decline [which is meant in relation to the fate of “Being”] and to appraise it as such. This simple observation has nothing to do with cultural pessimism — nor with any optimism either, of course; for the darkening of the world, the flight of the gods, the destruction of the earth, the reduction of human beings to a mass, the hatred and mistrust of everything creative and free has already reached such proportions throughout the whole earth that such childish categories as pessimism and optimism have long become laughable. [3] [6]
In a later passage, Heidegger emphatically reiterates much of this: “We said: on the earth, all over it, a darkening of the world is happening. The essential happenings in this darkening are: the flight of the gods, the destruction of the earth, the reduction of human beings to a mass, the preeminence of the mediocre.” [4] [7] Consider also this passage:
All things sank to the same level, to a surface resembling a blind mirror that no longer mirrors, that casts nothing back. The prevailing dimension became that of extension and number. To be able — this no longer means to spend and to lavish, thanks to lofty overabundance and the mastery of energies; instead, it means only practicing a routine in which anyone can be trained, always combined with a certain amount of sweat and display. In America and Russia, then, this all intensified until it turned into the measureless so-on and so-forth of the ever-identical and the indifferent, until finally this quantitative temper became a quality of its own. By now in those countries the predominance of a cross-section of the indifference is no longer something inconsequential and merely barren but is the onslaught of that which aggressively destroys all rank and all that is world-spiritual, and portrays these as a lie. This is the onslaught of what we call the demonic [in the sense of the destructively evil]. [5] [8]
Finally, let us consider a passage from a later text, What Is Called Thinking? (1953):
The African Sahara is only one kind of wasteland. The devastation of the earth can easily go hand in hand with a guaranteed supreme living standard for man, and just as easily with the organized establishment of a uniform state of happiness for all men. Devastation can be the same as both, and can haunt us everywhere in the most unearthly way — by keeping itself hidden. Devastation does not just mean a slow sinking into the sands. Devastation is the high-velocity expulsion of Mnemosyne. The words, “the wasteland grows,” come from another realm than the current appraisals of our age. Nietzsche said, “the wasteland grows” nearly three quarters of a century ago. And he added, “Woe to him who hides wastelands within.” [6] [9]
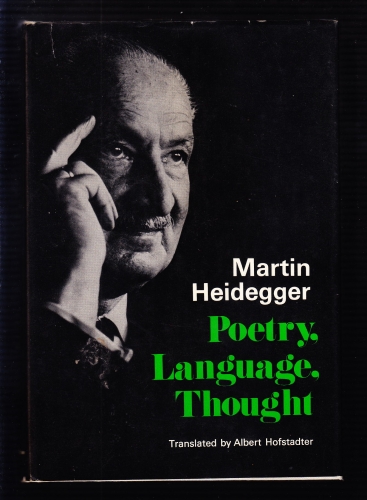
These passages give a fairly good summation of the essentials of Heidegger’s critique of modernity, which is worked out in much greater detail in his entire oeuvre. (Arguably, Heidegger’s confrontation with modernity is the central feature of his entire philosophy.) We may note here, especially, four major points. [7] [10] I will set these out below, along with quotations from Guénon’s Reign of Quantity, for comparison:
(a) The predominance of the “quantitative” in modernity; the triumph of the quantitative over the qualitative:
Guénon: “The descending movement of manifestation, and consequently that of the cycle of which it is an expression, takes place away from the positive or essential pole of existence toward its negative or substantial pole, and the result is that all things must progressively take on a decreasingly qualitative and an increasingly quantitative aspect; and that is why the last period of the cycle must show a very special tendency toward the establishment of a ‘reign of quantity.’” [8] [11]
(b) The cancellation of distance in the modern period; the increasing “speed” of modernity:
Guénon: “[Events] are being unfolded nowadays with a speed unexampled in the earlier ages, and this speed goes on increasing and will continue to increase up to the end of the cycle; there is thus something like a progressive ‘contraction’ of duration, the limit of which corresponds to the ‘stopping-point’ previously alluded to; it will be necessary to return to a special consideration of these matters later on, and to explain them more fully.” [9] [12]
And:
“The increase in the speed of events, as the end of the cycle draws near, can be compared to the acceleration that takes place in the fall of heavy bodies: the course of the development of the present humanity closely resembles the movement of a mobile body running down a slope and going faster as it approaches the bottom . . .” [10] [13]
(c) Modernity’s leveling effect; the destruction of an order of rank:
Guénon: “It is no less obvious that differences of aptitude cannot in spite of everything be entirely suppressed, so that a uniform education will not give exactly the same results for all; but it is all too true that, although it cannot confer on anyone qualities that he does not possess, it is on the contrary very well fitted to suppress in everyone all possibilities above the common level; thus the ‘leveling’ always works downward: indeed, it could not work in any other way, being itself only an expression of the tendency toward the lowest, that is, toward pure quantity . . .” [11] [14]
(d) Modernity’s reduction of everything to uniformity:
Guénon: “A mere glance at things as they are is enough to make it clear that the aim is everywhere to reduce everything to uniformity, whether it be human beings themselves or the things among which they live, and it is obvious that such a result can only be obtained by suppressing as far as possible every qualitative distinction . . .” [12] [15]

In later works, Heidegger explicitly ties modernity’s will towards uniformity to the “mechanization” of human beings. The spirit of technology becomes so totalizing that finally human beings themselves are “requisitioned” (to use a Heideggerian expression) and integrated as subsidiary mechanisms within the vast machine of modernity. In this connection, consider this passage from Guénon, worth quoting at length:
Servant of the machine, the man must become a machine himself, and thenceforth his work has nothing really human in it, for it no longer implies the putting to work of any of the qualities that really constitute human nature. The end of all this is what is called in present-day jargon ‘mass-production,’ the purpose of which is only to produce the greatest possible quantity of objects, and of objects as exactly alike as possible, intended for the use of men who are supposed to be no less alike; that is indeed the triumph of quantity, as was pointed out earlier, and it is by the same token the triumph of uniformity. These men who are reduced to mere numerical ‘units’ are expected to live in what can scarcely be called houses, for that would be to misuse the word, but in ‘hives’ of which the compartments will all be planned on the same model, and furnished with objects made by ‘mass-production,’ in such a way as to cause to disappear from the environment in which the people live every qualitative difference. [13] [16]
One last quotation from Guénon: “Man ‘mechanized’ everything and ended at last by mechanizing himself, falling little by little into the condition of numerical units, parodying unity, yet lost in the uniformity and indistinction of the ‘masses,’ that is, in pure multiplicity and nothing else. Surely that is the most complete triumph of quantity over quality that can be imagined.” [14] [17]
It would be pointless to amass further such quotations from Guénon since his work is replete with them — and since many of my readers are much more familiar with Guénon’s work than with Heidegger’s. It would be equally pointless to quote the many virtually identical observations from Evola (who is probably much more familiar to my readers even than Guénon). A substantial amount of Evola’s work is occupied with elaborating and extending Guénon’s critique of modernity, to which Evola devoted entire volumes (e.g., Revolt Against the Modern World, Ride the Tiger, Men Among the Ruins, etc.). However, their positions diverge when Evola advocates that the superior man respond to modernity by “riding the tiger” (i.e., utilizing certain negative elements of the modern world, which might destroy lesser men, for the positive purpose of self-realization).
3. The Evola Quotation in Heidegger’s Nachlass
The foregoing has hopefully demonstrated to the reader that Heidegger and Guénon held strikingly similar views on modernity. Although Heidegger knew individuals who respected Guénon (e.g., Carl Schmitt and Ernst Jünger), no evidence has emerged that Heidegger actually read Guénon’s work. Very recently, however, evidence has emerged that Heidegger read Evola. However, far from supporting the idea that Heidegger was influenced by Evola or sympathetic to him, an examination of this evidence will demonstrate exactly where Heidegger parts company with Traditionalism. [15] [20]

Amongst Heidegger’s Nachlass (the papers left behind after his death) a handwritten note has been found in which the philosopher quotes a passage from Friedrich Bauer’s 1935 German translation of Revolt Against the Modern World (Erhebung wider die moderne Welt). Here is the passage as Heidegger copied it out:
Wenn eine Rasse die Berührung mit dem, was allein Beständigkeit hat und geben kann — mit der Welt des Seyns — verloren hat, dann sinken die von ihr gebildeten kollektiven Organismen, welches immer ihre Größe und Macht sei, schicksalhaft in die Welt der Zufälligkeit herab.
And here is a translation:
When a race has lost contact with what alone has and can give it permanence [or “stability,” Beständigkeit] — with the world of Beyng [Seyns] then the collective organisms formed by it, whatever be their greatness and power, are destined to sink down into the world of contingency.
For comparison, here is the entire passage from Bauer’s text:
Wenn eine Rasse die Berührung mit dem, was allein Beständigkeit hat und geben kann — mit der Welt des “Seins” — verloren hat, dann sinken die von ihr gebildeten kollektiven Organismen, welches immer ihre Größe und Macht sei, schicksalhaft in die Welt der Zufälligkeit herab: werden Beute des Irrationalen, des Veränderlichen, des “Geschichtichen,” dessen, was von unten und von außen her bedingt ist. [16] [21]
We immediately notice two things when Heidegger’s handwritten version is compared to the original. First, Heidegger has rendered Sein as Seyn. [17] [22] Second, Heidegger replaces a colon with a period and omits the last part of the sentence entirely. The part after the colon can be translated as follows: “[to] become prey to the irrational, the changeable, the ‘historical,’ of what is conditioned from below and from the outside.” Why did Heidegger make these changes? Fully answering this question will allow us to see that Heidegger actually rejects Evola’s Traditionalism in the most fundamental terms possible.
First of all, it is likely that this undated note comes from sometime in the 1930s. During this time, Heidegger began utilizing Seyn, an archaic German spelling of Sein (Being). [18] [23] But why? What did this signify? It was not simply eccentricity on Heidegger’s part. By Seyn, Heidegger meant something distinct from Sein, which refers to the Being that beings have (“Being as such”). Seyn instead refers to what Heidegger calls elsewhere “the clearing” (die Lichtung). This metaphorical expression refers to a clearing in a forest, which allows light to enter in and illuminate what stands within the clearing. Thomas Sheehan describes Heidegger’s clearing as “the always already opened-up ‘space’ that makes the being of things (phenomenologically: the intelligibility of things) possible and necessary.” [19] [24] The clearing is what “gives” Being.
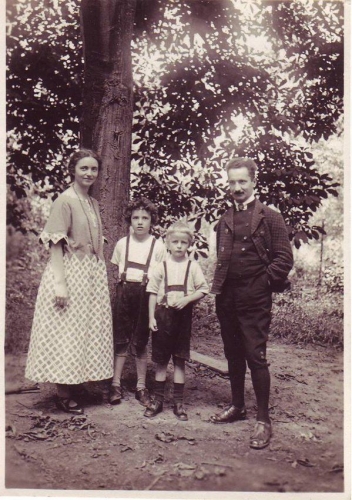
Heidegger writes in “The End of Philosophy and the Task of Thinking” (1964):
The forest clearing is experienced in contrast to dense forest, called Dickung in our older language. The substantive “opening” [Lichtung] goes back to the verb “open” [lichten]. The adjective licht “open” is the same word as “light.” To open something means: to make something light, free and open, e.g., to make the forest free of trees at one place. The openness thus originating is the clearing. . . . Light can stream into the clearing, into its openness, and let brightness play with darkness in it. But light never first creates openness. Rather, light presupposes openness. However, the clearing, the opening, is not only free for brightness and darkness, but also for resonance and echo, for sounding and the diminishing of sound. The clearing is the open region for everything that becomes present and absent. . . . What the word [opening] designates in the connection we are now thinking, free openness, is a “primal phenomenon” [Urphänomenon], to use a word of Goethe’s. [20] [25]
Consider a simple example. I approach an unfamiliar object sitting on my doorstep. I cannot place it; try as I might it remains a mystery. But as I approach closer still, all is revealed: I see now that it is an Amazon box. In this moment, what has occurred is that the Being of the object — what it is, what its meaning is — becomes present to me. [21] [26] In order for this to be possible at all, I must bear within me a certain special sort of “openness,” within which the Being of something makes itself known or makes itself present. [22] [27]
Contrary to how empiricists tend to conceive things, I don’t actually experience myself as hanging a label onto the object or slotting it within a mental category. This is an analysis after the fact of experience, not what I actually experience. If we are truer to the phenomenon than the empiricists (i.e., if we are good phenomenologists) we have to report that the experience is actually one in which the Being of the thing seems to “come forth,” or to display itself as we explore the object. But, again, this is only possible because of the “openness” referred to earlier. In this openness, Being displays itself; it is “lit up” within the space of the metaphorical “clearing.”

Thus, for Heidegger it is possible to speak of something deeper or more ultimate than Being itself (hence, an Urphänomenon): that which allows our encounter with the Being of beings in the first place; the open clearing. When Heidegger famously refers to “the forgottenness of Being” (Vergessenheit des Seins) he is actually referring to the forgottenness of the clearing. [23] [28] The clearing is forgotten in the sense that we have forgotten that in virtue of which Being is given to us. As I will discuss later, Heidegger holds that the Western metaphysical tradition, beginning with the Pre-Socratics, systematically forgets the clearing, and he traces all of our modern ills to this forgetting. He writes: “In fact, the history of Western thought begins, not by thinking what is most thought-provoking, but by letting it remain forgotten.” [24] [29]
Now, by contrast, when Evola speaks of “the world of being” (Welt des Seins; mondo di essere) in this passage and elsewhere, he is referring to a Platonic realm of timeless essences that are the true beings, in contrast to the changeful, impermanent terrestrial beings we encounter with the five senses. Traditionalism is heavily dependent on this Platonic metaphysics. Consider, for example, Evola’s words from the very beginning of Revolt:
In order to understand both the spirit of Tradition and its antithesis, modern civilization, it is necessary to begin with the fundamental doctrine of the two natures. According to this doctrine there is a physical order of things and a metaphysical one; there is a mortal nature and an immortal one; there is the superior realm of “being” and the inferior realm of “becoming.” Generally speaking, there is a visible and tangible dimension and, prior to and beyond it, an invisible and intangible dimension that is the support, the source, and the true life of the former. [25] [30]
Not only does Heidegger reject this Platonic metaphysics, he sees it as the first major stage in the decline of the West. Its inception is essentially identical with the “forgottenness” of the clearing spoken of a moment ago. All the aspects of modernity Heidegger was quoted earlier as deploring are ultimately traceable, he believes, to Platonic metaphysics. Thus, Heidegger completely rejects the idea that a “race” declines when it has “lost contact” with being, in the Platonic sense of “being” meant by Evola. Quite the reverse: a race — our race — has declined precisely through its turn toward Platonic metaphysics, and its turn away from the clearing. Thus, when Heidegger swaps Sein for Seyn, he is entirely changing the meaning of what Evola is saying. He is rewriting the passage so that it agrees with his own position: the decline of the West stems from its forgottenness of Seyn (the clearing) and its embrace of the Platonic Sein of the Western metaphysical tradition.
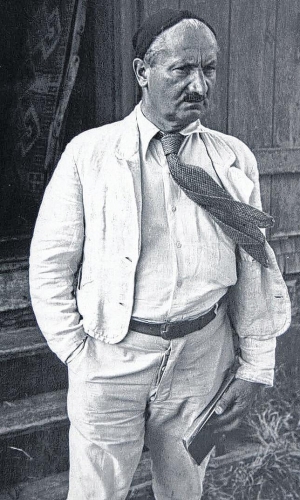
Heidegger omits the last part of Evola’s sentence for similar reasons. Let us look again at those words. Evola tells us that when a race has lost contact with “the world of being” it will “become prey to the irrational, the changeable, the ‘historical,’ of what is conditioned from below and from the outside.” Heidegger omits these words because he rejects Evola’s dichotomy between “being” and “the historical.” Heidegger argues, in fact, that Beyng/the clearing is inherently historical (geschichtlich), and changeable (veränderlich). The Being of things actually changes as culture changes. This is the same thing, fundamentally, as saying that the meaning of things changes over time.
But could the Being/meaning of the Amazon box on my doorstep ever change? Of course. Imagine a future world without Amazon, or one in which Amazon has been declared a monopoly and broken up into a number of different, competing entities. No more Amazon boxes on doorsteps. When you do see them, you see them in museums and you no longer see them simply as utilitarian objects. You no longer think, on glimpsing one, “Oh, my copy of Being and Time has arrived,” or some such. Instead, the Amazon box takes on a new meaning: as a symbol of a dark time we are, happily, well beyond; a time in which we allowed companies like Amazon not only to corner the market and put all smaller competitors out of business, but to shape the information we have access to through censorship and the banning of books [31].
Thus, if the Being or meaning that things have for us changes over the course of history, as culture and circumstances change, then, contra Evola, Being is inescapably “changeable” and “historical.” Evola also says that a race which loses contact with his idea of being falls prey to “the irrational” (das Irrational, in the German translation). Would Heidegger endorse this as well? Is his idea of Being “irrational”? Well, Heidegger does argue that historical-cultural shifts in Being/meaning are not fully intelligible to human beings. The reason for this is that it is always within Beyng/the clearing that things are meaningful or intelligible to us. It therefore follows that Beyng/the clearing itself is not ultimately intelligible. In a highly qualified sense, we could thus describe it as “irrational.” That Evola implicitly endorses the equation of being with “the rational” in this passage is extremely ironic. As we will see in a later installment, Heidegger argues that this equation is a key feature of the modern inflection of the Western metaphysical tradition, and that all the modern maladies Evola decries are ultimately attributable to it.
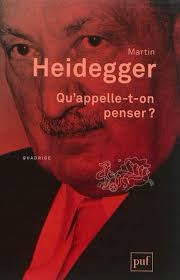 Heidegger would have regarded Guénon and Evola as philosophically naïve—for several reasons. First, they uncritically appropriate the Western metaphysical tradition in the name of combating modernity. Yet, as I have already mentioned, Heidegger argues that that tradition is implicated in the decline of the West. Second, the Traditionalists naïvely assert that this metaphysical tradition is “perennial” or timeless. They take Platonism as preserving elements of a primordial tradition that antedates Plato by millennia. They hold that the time of Plato belongs to the Kali Yuga (the fourth age, the decadent “Iron Age”), but they take Plato (and other ancient philosophers) to be preserving an older, indeed timeless wisdom. However, this is pure speculation, for which there is no solid scholarly evidence. [26] [32]
Heidegger would have regarded Guénon and Evola as philosophically naïve—for several reasons. First, they uncritically appropriate the Western metaphysical tradition in the name of combating modernity. Yet, as I have already mentioned, Heidegger argues that that tradition is implicated in the decline of the West. Second, the Traditionalists naïvely assert that this metaphysical tradition is “perennial” or timeless. They take Platonism as preserving elements of a primordial tradition that antedates Plato by millennia. They hold that the time of Plato belongs to the Kali Yuga (the fourth age, the decadent “Iron Age”), but they take Plato (and other ancient philosophers) to be preserving an older, indeed timeless wisdom. However, this is pure speculation, for which there is no solid scholarly evidence. [26] [32]
A further Heideggerian objection to Traditionalism may be considered at this point, and it is an extremely serious one. Both Heidegger and the Traditionalists decry rootless modern individualism. However, Heidegger’s critique goes much further. Recall that for the philosopher Being is inherently historical and changeable. What things are for us, or what they mean, is determined in part by our historical situation. Human Dasein is always embedded in a set of concrete historical, cultural circumstances. Heidegger writes: “Only insofar as the human being exists in a definite history are beings given, is truth given. There is no truth given in itself; rather, truth is decision and fate for human beings; it is something human.” [27] [33] This does not, however, mean that truth, as human, is something “subjective”:
We are not humanizing the essence of truth: to the contrary, we are determining the essence of human beings on the basis of truth. Man is transposed into the various gradations of truth. Truth is not above or in man, but man is in truth. Man is in truth inasmuch as truth is this happening of the unconcealment of things on the basis of creative projection. Each individual does not consciously carry out this creative projection; instead, he is already born into a community; he already grows up within a quite definite truth, which he confronts to a greater or lesser degree. Man is the one whose history displays the happening of truth. [28] [34]

As a result of this stance, Heidegger rejects both the Enlightenment ideal of a “view from nowhere,” as well as rootless, modern cosmopolitanism.
Consider, however, the following lines from The Reign of Quantity. Guénon writes disapprovingly of “those among the moderns who consider themselves to be outside all religion” — i.e., freethinking individualists. He asserts that such men are “at the extreme opposite point from those who, having penetrated to the principial unity of all the traditions, are no longer tied to any particular form.” This latter position, of course, is that of Guénonian Traditionalism itself. In a footnote, he then approvingly quotes Ibn ‘Arabî: “My heart has become capable of all forms: it is a pasture for gazelles and a monastery for Christian monks, and a temple for idols, and the Kaabah of the pilgrim, and the table of the Thorah and the book of the Quran. I am the religion of Love, whatever road his camels may take; my religion and my faith are the true religion.” [29] [35]
Though Guénon contrasts the position of the modern freethinker to the Traditionalist, Heidegger would doubtless argue that there is a fundamental identity between them. The freethinker imagines that he has freed himself from any cultural-religious context and become a kind of intellectual or spiritual cosmopolitan. Yet the Traditionalist thinks the exact same thing. The only difference is that the freethinker believes he has cast off religion or “spirituality” itself, whereas the Traditionalist imagines that he adheres to a decontextualized, ahistorical, and universal spiritual construct called “Tradition.” This standpoint too is fundamentally modern.
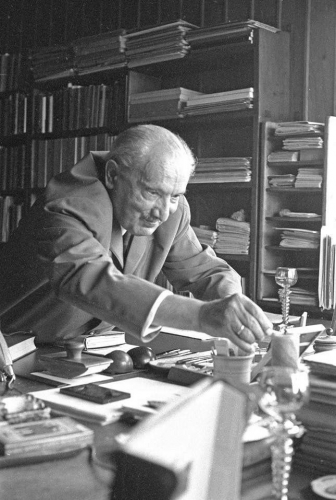
One might object, however, that Guénon’s decision to convert to Islam and “go native” in Cairo, where he spent the last twenty years of his life, indicates that he was aware that tradition could not be a free-floating abstraction, and that to be a true Traditionalist one had to choose a living tradition and immerse oneself in it. This is true, as a statement of Guénon’s views. But the very idea that one can choose a tradition buys into the modern conception of the autonomous self who may, from a standpoint of detachment from any cultural or historical context, survey the different traditions and select one. It is no use here to point out that all Muslims must, in a sense, “choose” Islam, as it is not an ethnic religion but a creedal one, whose faith all adherents must profess, and to which anyone may convert. This is a valid point, but a superficial one. Islam emerged from a cultural and historical context quite alien to the West, and which no Westerner may ever truly enter.
4. Conclusion
Let us now consider a couple of objections to this Heideggerian critique of Traditionalism.
First, defenders of Traditionalism might respond that Guénon and Evola are primarily grounded in the Indian tradition, and not in Western metaphysics at all. There are essentially two pieces of evidence for this claim. The first is Guénon and Evola’s endorsement of the Hindu cyclical account of time, of the yugas, which is indeed quite ancient. Both seem to accept this teaching in very literal terms, right down to the traditional Hindu calculations of the time span of each yuga (which strike most modern readers as arbitrary inventions). Second is the primacy granted by both thinkers to Vedanta. Both Guénon and Evola regard the teachings of the Upanishads as an expression of a very ancient ur-metaphysics, which constitutes a “perennial philosophy.”

The dependence of the Traditionalists on the Indian tradition is very real. The trouble, however, is that they interpret the Indian materials in terms of the categories and terminology of Western metaphysics. Indeed, this is especially true of Guénon, who shows no signs of recognizing that there is anything problematic about understanding the Upanishads in terms derived from Platonic and Aristotelian philosophy. For example, right at the beginning of The Reign of Quantity, Guénon discusses the duality of Purusha and Prakriti using the categories of “essence and substance” — then, a page later, he appeals to “form and matter,” then to “act and potency.” [30] [38] This is all Aristotelian terminology. Moreover, there is no attempt on Guénon’s part to recover the “originary” sense of these terms in Aristotle. Instead, he unhesitatingly adopts the medieval scholastic understanding of these distinctions.
It may be that Guénon thought it was valid to discuss Vedanta in Platonic-Aristotelian terms because he regarded the Platonic tradition as itself an expression of the perennial philosophy. Thus, he simply decided a priori that Vedanta and Platonism are two streams flowing from the same source: primordial Tradition. But, again, this is pure speculation. The bottom line is that Guénon and Evola do accord special primacy to the Indian tradition over Western metaphysics — but they see the former almost entirely through the lens of the latter. Thus, despite their interest in Indian thought, they are still thoroughly beholden to Western metaphysics.
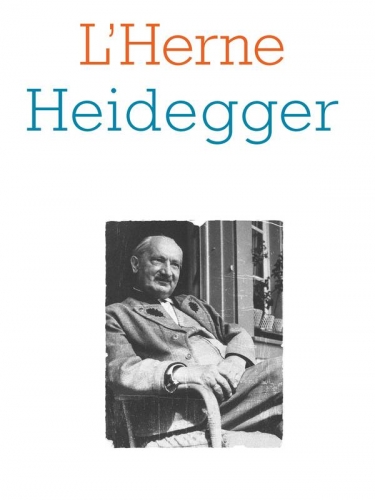
It remains to consider a further, much more significant, objection to these Heideggerian critiques of Traditionalism. The primary objection I have raised against Guénon and Evola is that they are thoroughly committed to Western metaphysics. This is a problem because Heidegger argues that the Western tradition is not only a falling away from a more primordial encounter with Being, it actually makes possible the modern decadence that Traditionalists rightly reject. But why we should follow Heidegger in any of this? Why should we accept Heidegger’s negative evaluation of Western metaphysics? Why should we accept the thesis that Platonic metaphysics made modernity possible? The next essay in this series will be devoted to addressing just these questions. It will be the first of several essays offering a compressed summary and commentary on Heidegger’s history and critique of metaphysics, demonstrating that the claims he makes are both plausible and profound. Heidegger is right in thinking that Western metaphysics lies at the root of modernity. We will begin with Heidegger’s critique of Plato.
What did Heidegger have to say about tradition? In “The Age of the World Picture” (1938) He warns us against “merely negating the age” and writes that “The flight into tradition, out of a combination of humility and presumption, achieves, in itself, nothing, is merely a closing the eyes and blindness towards the historical moment.” [31] [39] But Heidegger also argues that the turn toward metaphysics is a turn away from a more authentic way of encountering Being. It is in this latter conception that we find what may be the equivalent of “primordial tradition” in Heidegger’s thought. One of the conclusions that will be defended in this series of essays is that while Heidegger is clearly not a Guénonian or Evolian Traditionalist, he is actually more traditionalist than the Traditionalists.
Appendix. Outline of the Series:
Part One (the present essay): Why Heidegger and Traditionalism are not compatible; major errors in Traditionalism from a Heideggerian perspective.
Part Two: Heidegger’s history of metaphysics, focusing on his critique of Platonism. This account will deepen our understanding of why Heidegger would regard Traditionalism as a fundamentally modern movement, as well as deepen our understanding of modernity.
Part Three: The continuation of our account of Heidegger’s history of metaphysics, from Plato to Nietzsche. Among other things, Part Three will discuss Evola’s problematic indebtedness to German Idealism, especially J. G. Fichte, whose philosophy (I will argue) is like a vial of fast-acting, concentrated modern poison.
Part Four: From Nietzsche to the present age of post-War modernity, which Heidegger characterizes as das Gestell (“enframing”). Part Four will deal in detail with this fundamental Heideggerian concept, which is central to his critique of technology.
Part Five: How Heidegger proposes that we respond to technological modernity. His project of a “recovery” of a pre-metaphysical standpoint; his “preparation” for the next “dispensation of Beyng.” His phenomenology of authentic human “dwelling” (“the fourfold”), and Gelassenheit.
Part Six: A call for a new philosophical approach, building upon Heidegger and the Traditionalists, while moving beyond them. Three primary components: (1) The recovery of “poetic wisdom” (to borrow a term from G. B. Vico): Heidegger’s project of the recovery of the pre-metaphysical standpoint now applied to myth and folklore, and expanded to include non-Greek sources (e.g., the pre-Christian traditions of Northern Europe); (2) Expanding Heidegger’s project of the “destruction” of the Western tradition to include the Gnostic and Hermetic traditions, Western esotericism, and Western mysticism; (3) Finally, social and cultural criticism from a standpoint informed by the critique of metaphysics, critique of modernity, and recovery of “poetic wisdom.”
Notes
[1] [40] I will capitalize the “t” in Traditionalism to indicate the school of Guénon, Evola, et al., as opposed to “traditionalism” in the looser, broader sense of the term. This device is necessary, as I will be using the term in both senses. I should also note that it is primarily the Traditionalism of Guénon and Evola that I am concerned with here. I am comparatively less interested in the “softer” Traditionalism of figures like Coomaraswamy, Schuon, Huston Smith, etc. Most of the objections raised against Guénon and Evola herein would apply to these authors as well.
[2] [41] “Originary” (ursprünglich) is a term frequently used by Heidegger.
[3] [42] Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics, trans. Gregory Fried and Richard Polt (New Haven, CT: Yale University Press, 2000), 40-41. This was originally a lecture course given by Heidegger in 1935. It was published for the first time in German in 1953. The material in square brackets was added by Heidegger when the lecture course was published in 1953.
[4] [43] Fried and Polt, 47.
[5] [44] Fried and Polt, 48-49. Bracketed phrase added by Heidegger for the 1953 edition.
[6] [45] Martin Heidegger, What is Called Thinking?, trans. J. Glenn Gray (New York: Harper Perennial, 1968), 30.
[7] [46] One point is omitted from the discussion below, one which my readers might expect me to discuss: “the flight of the gods.” What Heidegger means by this, however, is complicated, and far from obvious. I will discuss this issue in a later essay.
[8] [47] René Guénon, The Reign of Quantity and the Signs of the Times, trans. Lord Northbourne (Hillsdale, NY: Sophia Perennis, 2001), 43.
[9] [48] Reign, 42
[10] [49] Reign, 43. For similar remarks see Julius Evola, Meditations on the Peaks, trans. Guido Stucco (Rochester, Vermont: Inner Traditions, 1998), 45-46.
[11] [50] Reign, 51-52.
[12] [51] Reign, 48.
[13] [52] Reign, pp. 60-61. Compare this to some remarks by Alexandre Kojève: “Hence it would have to be admitted that after the end of history men would construct their edifices and works of art as birds build their nests and spiders spin their webs, would perform their musical concerts after the fashion of frogs and cicadas, would play like young animals and would indulge in love like adult beasts.” See Introduction to the Reading of Hegel, ed. Raymond Queneau and Allan Bloom, trans. James H. Nichols, Jr. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969), 159 (footnote).
[14] [53] Reign p. 194.
[15] [54] The discovery of the note in 2015 received some attention in the German press. Writing in the Frankfurter Allgemeine Zeitung [55], Thomas Vasek claims that “textual comparisons suggest that Heidegger had not only read Evola, as this note indicates, but was also influenced by his ideas from the mid-thirties on, from his critique of science and technology, his anti-humanism and rejection of Christianity, to his ‘spiritual’ racism.” This is a completely baseless, and, indeed, ludicrous assertion, as I will shortly demonstrate. See Greg Johnson’s analysis of the Heidegger note, and Vasek’s article, here [56].
[16] [57] Julius Evola, Erhebung wider die moderne Welt, trans. Friedrich Bauer (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1935), 65. The translator actually leaves out portions of Evola’s text, but since Heidegger only read the translation and not the original, these omissions do not concern us here. For the full passage in English translation, see Julius Evola, Revolt Against the Modern World, trans. Guido Stucco (Rochester, VT: Inner Traditions, 1995), 56-57.
[17] [58] The “s” at the end of Seins/Seyns in the passage simply indicates the genitive case. The nominative is Sein/Seyn.
[18] [59] Anglophone translators of Heidegger have adopted the convention of rendering Seyn as “Beying.”
[19] [60] Thomas Sheehan, Making Sense of Heidegger: A Paradigm Shift (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2015), 20.
[20] [61] Martin Heidegger, Basic Writings, ed. David Farrell Krell (New York: Harper and Row, 1977), 384-385. This essay was translated by Joan Stambaugh; italics added.
[21] [62] Sheehan argues at length that, for Heidegger, Being and meaning are identical.
[22] [63] This way of expressing things should be understood as figurative, and preliminary. Actually, Heidegger wants to entirely avoid a “subjective” treatment of the clearing as some sort of “faculty” or Kantian a priori structure that I “bear within me.” The reason, at root, is that this treatment of the clearing is phenomenologically untrue. I do not, in fact, experience the clearing as something “in me” that is “mine.” Still less do I experience it as something over which I have any kind of influence or control. There is thus no real basis for “subjectivizing” the clearing; for locating it “within the subject.” Indeed, Heidegger critiques the subject/object distinction prevailing in philosophy since Descartes, which locates certain “properties” as “within” a subject, as if this subject is a kind of cabinet in which we dwell, removed from an “external world.” See Heidegger, Being and Time, trans. Joan Stambaugh, rev. Dennis J. Schmidt (Albany, NY: State University of New York Press, 2010), 60-61.
[23] [64] Generally speaking, this is correct. Unfortunately, Heidegger is inconsistent with his use of Sein/Seyn, sometimes referring to Being, sometimes to the clearing that gives Being.
[24] [65] What is Called Thinking?, 152.
[25] [66] Revolt, 3.
[26] [67] The Traditionalists are in much the same position as the Renaissance “Hermeticists” who falsely believed that the Corpus Hermeticum contained an Egyptian wisdom that far antedated Plato and the Greeks, and from whom those philosophers had taken their basic doctrines. In reality, the Corpus Hermeticum was no older than the first century BC, and it derived its doctrines, in large measure, from Plato and his school.
[27] [68] Martin Heidegger, Being and Truth, trans. Gregory Fried and Richard Polt (Bloomington: Indiana University Press, 210), 134. Italics in original.
[28] [69] Being and Truth, 136. Italics in original.
[29] [70] Reign, 62-63.
[30] [71] Reign, 11-12.
[31] [72] Martin Heidegger, Off the Beaten Track, trans. Julian Young and Kenneth Haynes (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 72.




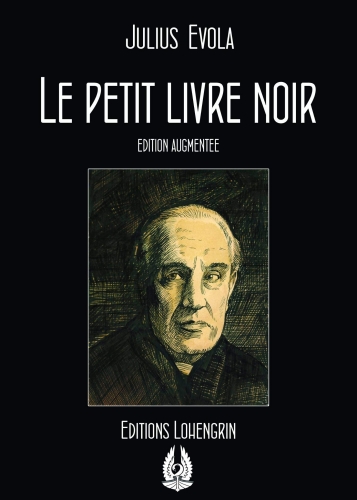

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
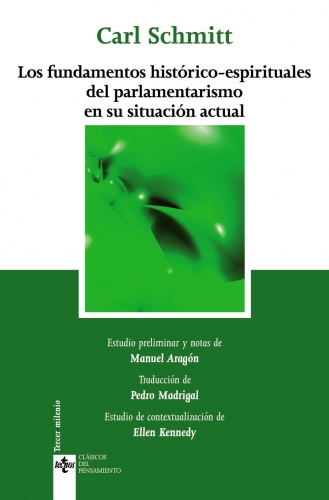




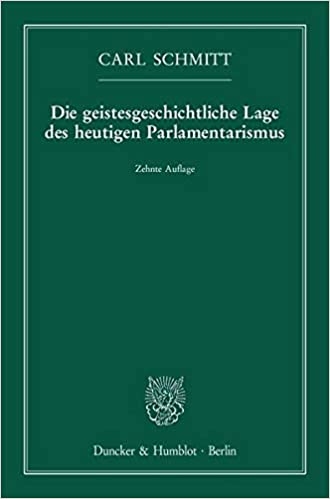
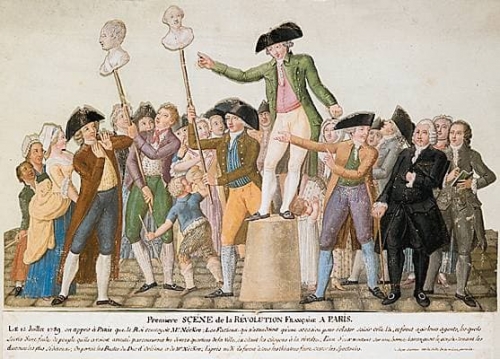
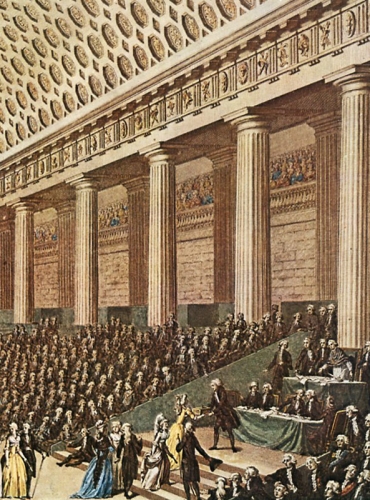


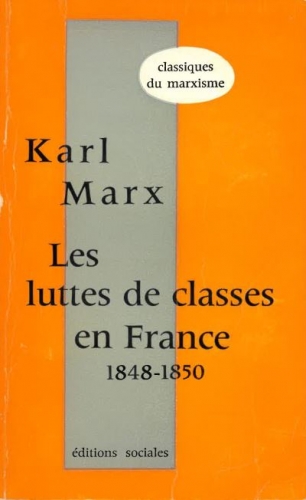

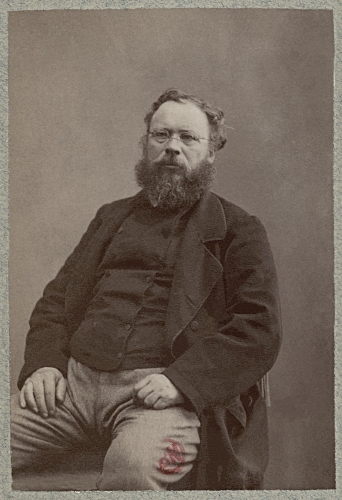

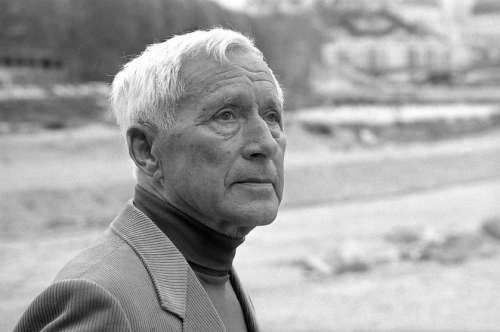
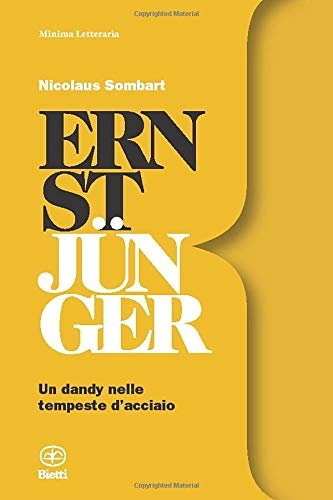

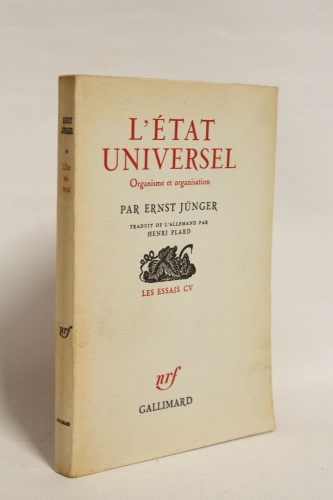
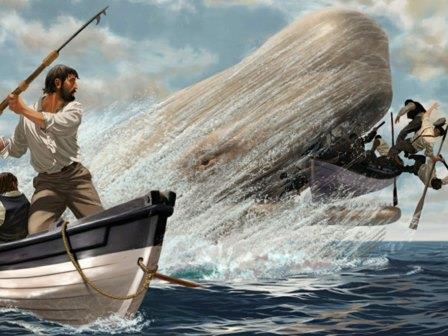
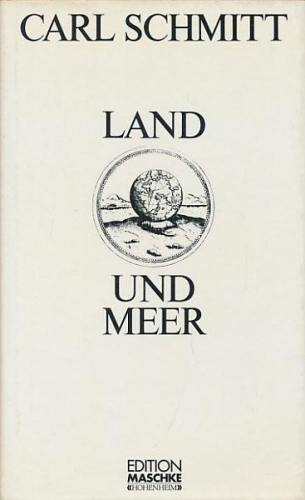


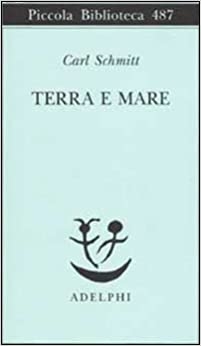


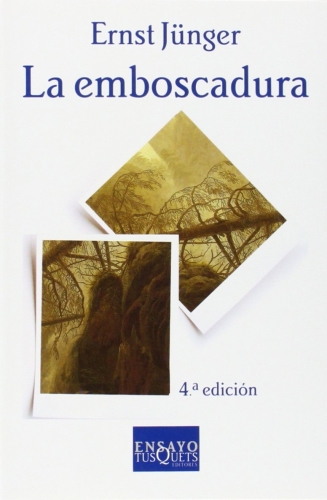
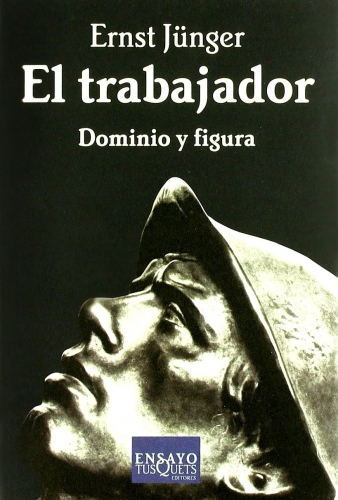
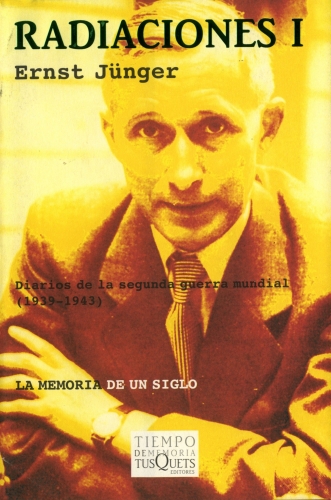

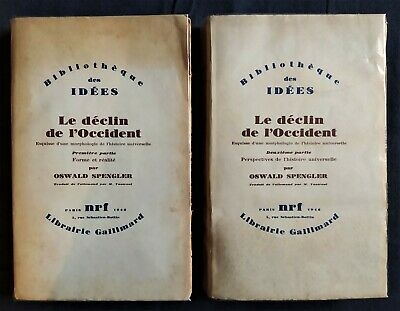
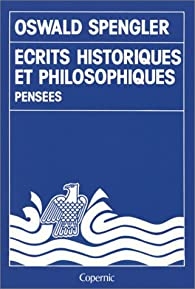 Les évaluations du travail de Spengler étaient différentes, parfois diamétralement opposées. L'une des premières estimations appartient au philosophe et sociologue allemand Georg Simmel (1858-1918). Il a pris connaissance du premier volume du Déclin de l'Occident un mois avant sa mort et a qualifié l'œuvre de Spengler de "philosophie la plus significative de l'histoire après Hegel". Mais le philosophe et culturologue allemand Walter Benjamin (1892-1940) considérait l'auteur du Déclin de l'Occident comme "un petit chien sans intérêt".
Les évaluations du travail de Spengler étaient différentes, parfois diamétralement opposées. L'une des premières estimations appartient au philosophe et sociologue allemand Georg Simmel (1858-1918). Il a pris connaissance du premier volume du Déclin de l'Occident un mois avant sa mort et a qualifié l'œuvre de Spengler de "philosophie la plus significative de l'histoire après Hegel". Mais le philosophe et culturologue allemand Walter Benjamin (1892-1940) considérait l'auteur du Déclin de l'Occident comme "un petit chien sans intérêt".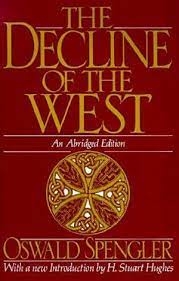 Spengler considère la science historique officielle comme primitive : "Le monde antique, le Moyen Âge, les temps modernes : voilà un schéma incroyablement maigre et vide de sens". Spengler oppose ce schéma linéaire à son schéma morphologique. La morphologie est une science née dans le cadre des sciences naturelles, qui étudie la structure et les formes des différents objets du monde matériel : minéraux, végétaux, organismes vivants. Et Spengler applique le schéma de l'étude morphologique de la nature à la société humaine. Pour Spengler, toute société est un organisme à la structure complexe, aux éléments et aux formes interconnectés. Et cet organisme social s'appelle "culture". Toute culture est précédée par la naissance d'une "âme", par laquelle Spengler entend une nouvelle vision du monde (religieuse ou scientifique) : "Toute nouvelle culture s'éveille avec une certaine nouvelle vision du monde".
Spengler considère la science historique officielle comme primitive : "Le monde antique, le Moyen Âge, les temps modernes : voilà un schéma incroyablement maigre et vide de sens". Spengler oppose ce schéma linéaire à son schéma morphologique. La morphologie est une science née dans le cadre des sciences naturelles, qui étudie la structure et les formes des différents objets du monde matériel : minéraux, végétaux, organismes vivants. Et Spengler applique le schéma de l'étude morphologique de la nature à la société humaine. Pour Spengler, toute société est un organisme à la structure complexe, aux éléments et aux formes interconnectés. Et cet organisme social s'appelle "culture". Toute culture est précédée par la naissance d'une "âme", par laquelle Spengler entend une nouvelle vision du monde (religieuse ou scientifique) : "Toute nouvelle culture s'éveille avec une certaine nouvelle vision du monde".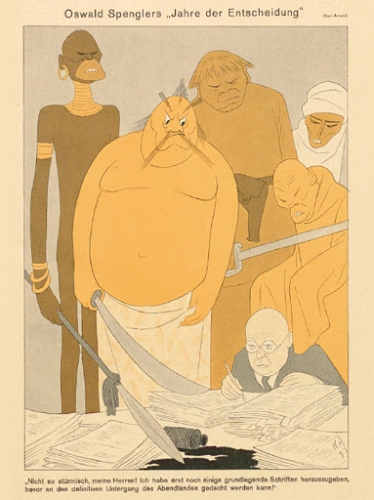
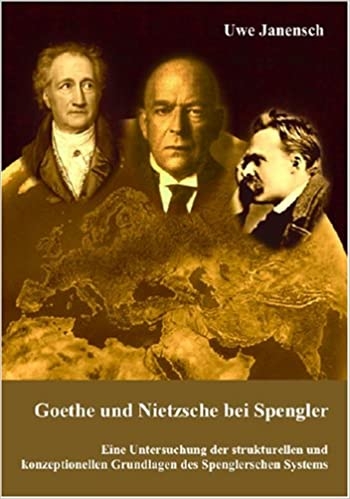 En réponse à ces attaques, Spengler a déclaré que s'il avait réellement étudié les œuvres d'un cercle aussi large de personnes intelligentes, voire brillantes, il n'aurait pas eu le temps d'écrire ses propres œuvres. Spengler a admis qu'il avait des prédécesseurs: Johann Wolfgang Goethe et Friedrich Nietzsche. Les deux sont les idoles de Spengler. Voici un extrait des notes de Spengler sur Nietzsche : "Il a découvert la tonalité des cultures étrangères. Personne avant lui n'avait la moindre idée du rythme de l'histoire...... Dans le tableau de l'histoire, que les recherches scientifiques ultérieures ont résumé en dates et en chiffres, il a d'abord connu un changement rythmique d'époques, de mœurs et de modes de pensée, de races entières et de grands individus, comme une sorte de symphonie ... Le musicien Nietzsche élève l'art du sentiment au style et au sentiment des cultures étrangères, sans tenir compte des sources et souvent en contradiction avec elles, mais quel sens !". Dans les notes autobiographiques de Spengler, publiées après sa mort, on trouve une telle révélation : "J'ai toujours été un aristocrate. Nietzsche était clair pour moi avant même que je ne le connaisse."
En réponse à ces attaques, Spengler a déclaré que s'il avait réellement étudié les œuvres d'un cercle aussi large de personnes intelligentes, voire brillantes, il n'aurait pas eu le temps d'écrire ses propres œuvres. Spengler a admis qu'il avait des prédécesseurs: Johann Wolfgang Goethe et Friedrich Nietzsche. Les deux sont les idoles de Spengler. Voici un extrait des notes de Spengler sur Nietzsche : "Il a découvert la tonalité des cultures étrangères. Personne avant lui n'avait la moindre idée du rythme de l'histoire...... Dans le tableau de l'histoire, que les recherches scientifiques ultérieures ont résumé en dates et en chiffres, il a d'abord connu un changement rythmique d'époques, de mœurs et de modes de pensée, de races entières et de grands individus, comme une sorte de symphonie ... Le musicien Nietzsche élève l'art du sentiment au style et au sentiment des cultures étrangères, sans tenir compte des sources et souvent en contradiction avec elles, mais quel sens !". Dans les notes autobiographiques de Spengler, publiées après sa mort, on trouve une telle révélation : "J'ai toujours été un aristocrate. Nietzsche était clair pour moi avant même que je ne le connaisse."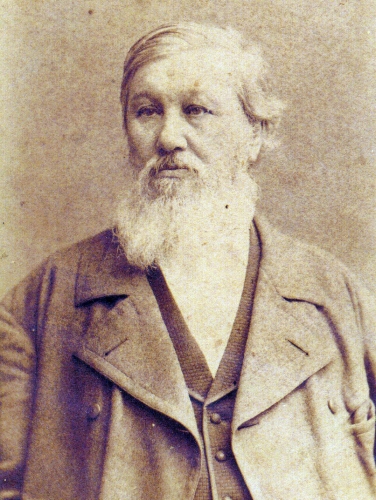
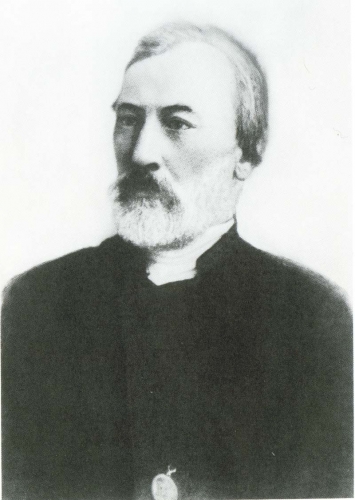
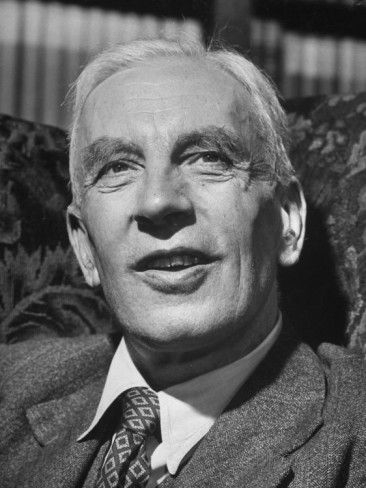
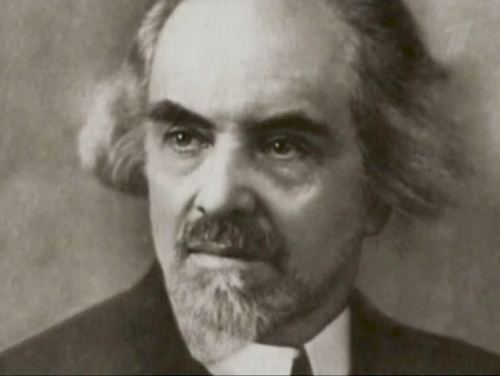
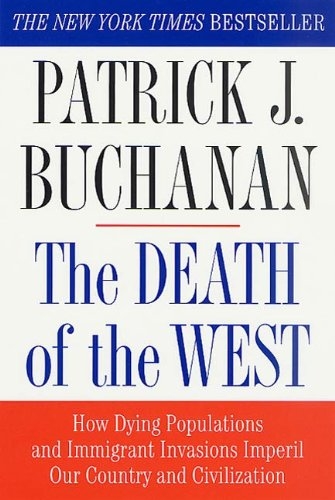


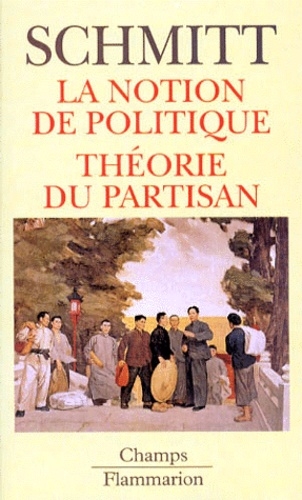 "Je ne dis pas la théorie générale de l'État ; car la catégorie, la théorie générale de l'État... est une préoccupation typique du 19ème siècle libéral. Cette catégorie découle de l'effort normatif visant à dissoudre l'État concret et le Volk concret dans des généralités (éducation générale, théorie générale du droit, et enfin théorie générale de la connaissance ; et de cette manière à détruire leur ordre politique" [1].
"Je ne dis pas la théorie générale de l'État ; car la catégorie, la théorie générale de l'État... est une préoccupation typique du 19ème siècle libéral. Cette catégorie découle de l'effort normatif visant à dissoudre l'État concret et le Volk concret dans des généralités (éducation générale, théorie générale du droit, et enfin théorie générale de la connaissance ; et de cette manière à détruire leur ordre politique" [1].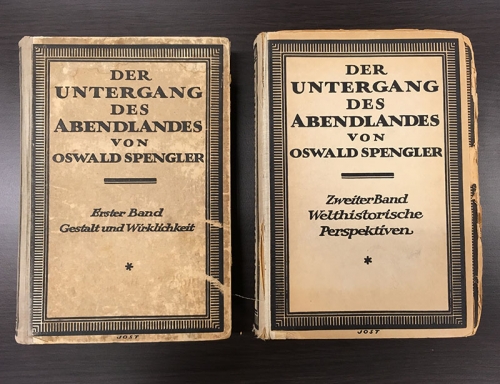
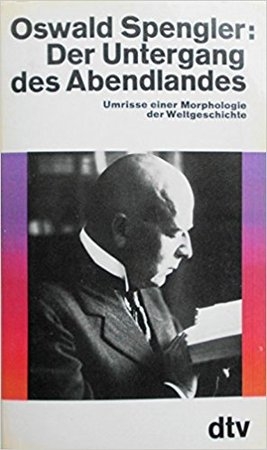 Le philosophe de l'histoire porte en lui un archétype, inné et non construit, et lorsque ces objets fluides lui sont présentés, il n'a pas le choix. Il déploie les potentialités de son archétype. Au niveau personnel et gnoséologique, il se passe la même chose que dans le cycle des cultures. L'âme de chaque culture, lorsqu'elle naît dans une parcelle primordiale, est tout entière un immense -mais non infini- rassemblement de possibilités : la biographie de cette culture est l'ensemble des manifestations déjà closes, qui se présentent à son regard et à sa compréhension. Une manifestation historique est déjà une obstruction à des possibilités qui n'ont pas eu lieu.
Le philosophe de l'histoire porte en lui un archétype, inné et non construit, et lorsque ces objets fluides lui sont présentés, il n'a pas le choix. Il déploie les potentialités de son archétype. Au niveau personnel et gnoséologique, il se passe la même chose que dans le cycle des cultures. L'âme de chaque culture, lorsqu'elle naît dans une parcelle primordiale, est tout entière un immense -mais non infini- rassemblement de possibilités : la biographie de cette culture est l'ensemble des manifestations déjà closes, qui se présentent à son regard et à sa compréhension. Une manifestation historique est déjà une obstruction à des possibilités qui n'ont pas eu lieu.
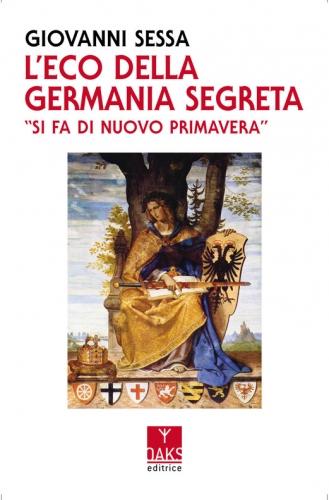
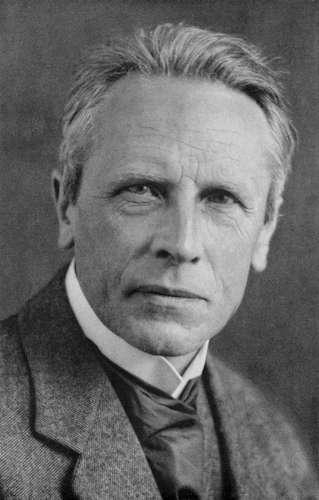
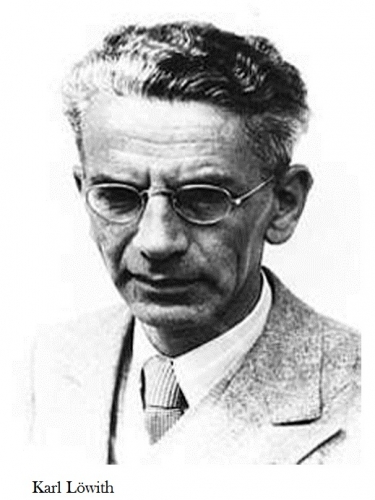
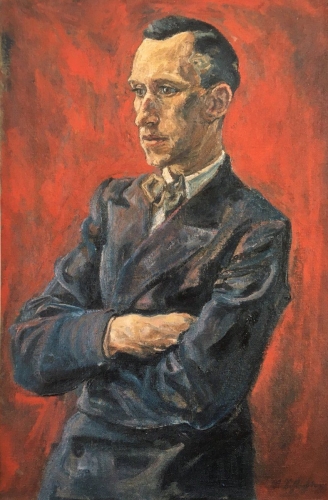
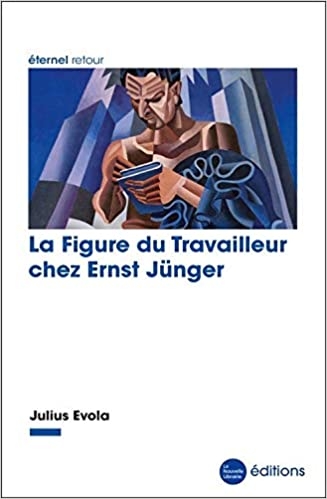 Pour se procurer les livres de Robert Steuckers sur la Révolution Conservatrice :
Pour se procurer les livres de Robert Steuckers sur la Révolution Conservatrice : 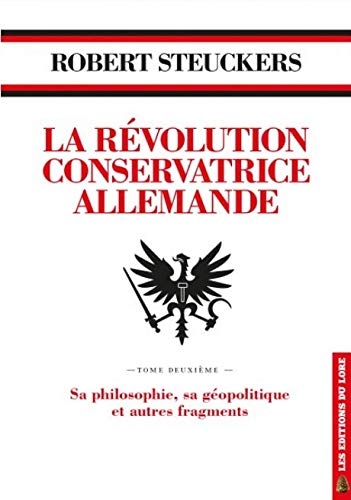
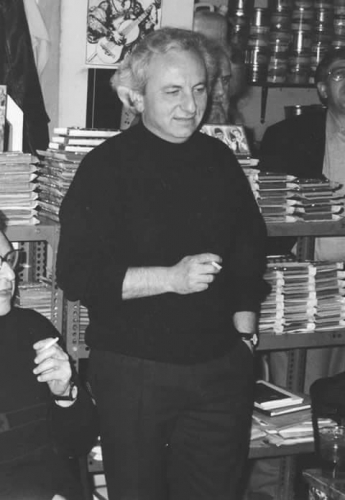
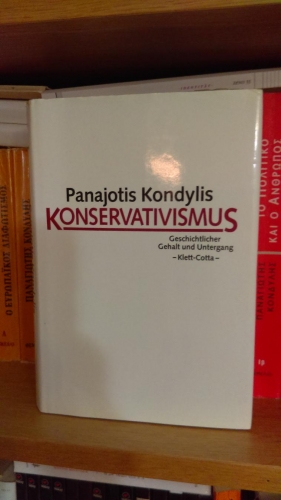
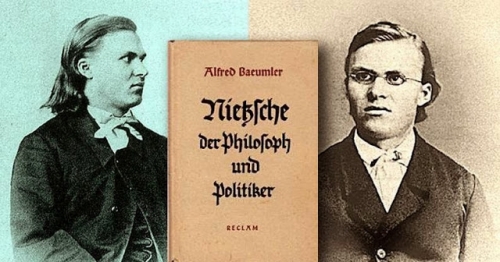
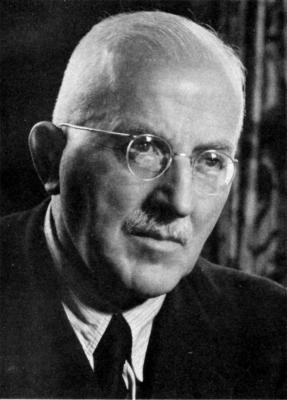 Alfred Baeumler a été le premier philosophe allemand à donner à Nietzsche une interprétation politique. Avant Jaspers et Heidegger, qui ont été influencés par lui, il a vu dans l'Allemagne "hellénique" envisagée par Nietzsche la représentation héroïque d'une révolution des valeurs primordiales incarnées dans la Grèce archaïque, dont le pivot philosophique et idéologique a été perçu dans le texte controversé de Nietzsche sur la volonté de puissance. Non systématique dans la forme, mais très cohérent sur le fond.
Alfred Baeumler a été le premier philosophe allemand à donner à Nietzsche une interprétation politique. Avant Jaspers et Heidegger, qui ont été influencés par lui, il a vu dans l'Allemagne "hellénique" envisagée par Nietzsche la représentation héroïque d'une révolution des valeurs primordiales incarnées dans la Grèce archaïque, dont le pivot philosophique et idéologique a été perçu dans le texte controversé de Nietzsche sur la volonté de puissance. Non systématique dans la forme, mais très cohérent sur le fond.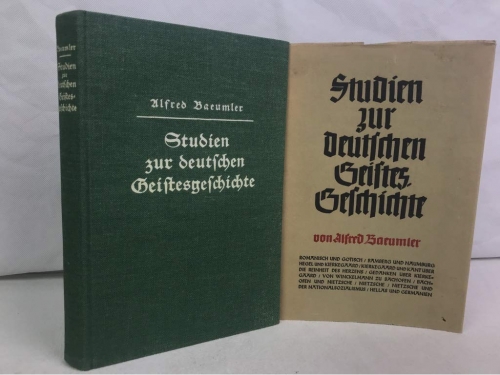
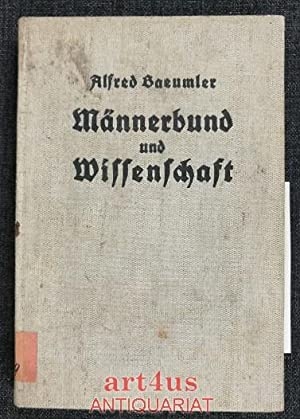 La publication des écrits de Baeumler - due à la seule maison d'édition italienne qui s'intéresse méthodiquement au philosophe allemand, délibérément occulté à cause des blocages mentaux persistants - s'inscrit dans l'effort culturel pour mettre fin, autant que possible, à l’époque des falsifications dogmatiques. Un document décisif qui va dans le même sens est, entre autres, le travail récent de Domenico Losurdo sur Nietzsche en tant que rebelle aristocratique. Publier Baeumler - comme l'ont fait les Edizioni di Ar avec les précédentes Estetica. e Nietzsche filosofo e politico (= Esthétiques et Nietzsche, philosophe et homme politique) - c'est laisser des traces visibles de cette contre-pensée intimement ancrée dans l'âme européenne et articulée sur la dénonciation du modernisme progressif comme masque du chaos final. Une telle démarche, aujourd'hui, est tout simplement ignorée, faute de moyens intellectuels, ou est pliée aux besoins du pouvoir censurant, ou est reléguée au placard où sont exilées les voix de la dissonance. Ce qui, dans la logique de la pensée unique, signifie condamnation et diffamation.
La publication des écrits de Baeumler - due à la seule maison d'édition italienne qui s'intéresse méthodiquement au philosophe allemand, délibérément occulté à cause des blocages mentaux persistants - s'inscrit dans l'effort culturel pour mettre fin, autant que possible, à l’époque des falsifications dogmatiques. Un document décisif qui va dans le même sens est, entre autres, le travail récent de Domenico Losurdo sur Nietzsche en tant que rebelle aristocratique. Publier Baeumler - comme l'ont fait les Edizioni di Ar avec les précédentes Estetica. e Nietzsche filosofo e politico (= Esthétiques et Nietzsche, philosophe et homme politique) - c'est laisser des traces visibles de cette contre-pensée intimement ancrée dans l'âme européenne et articulée sur la dénonciation du modernisme progressif comme masque du chaos final. Une telle démarche, aujourd'hui, est tout simplement ignorée, faute de moyens intellectuels, ou est pliée aux besoins du pouvoir censurant, ou est reléguée au placard où sont exilées les voix de la dissonance. Ce qui, dans la logique de la pensée unique, signifie condamnation et diffamation.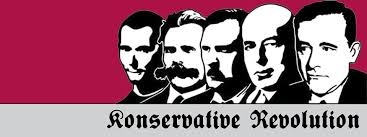
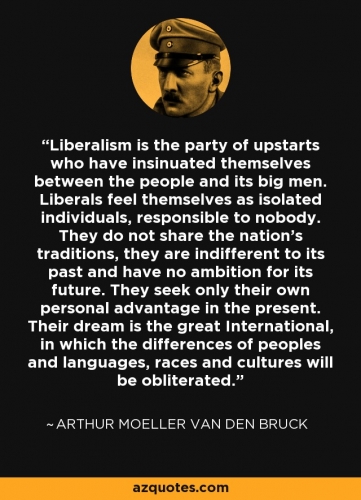
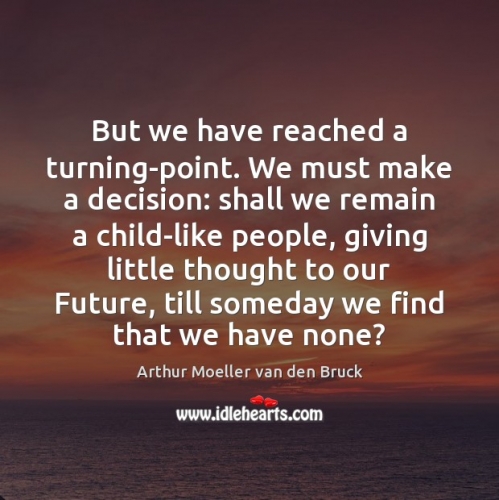
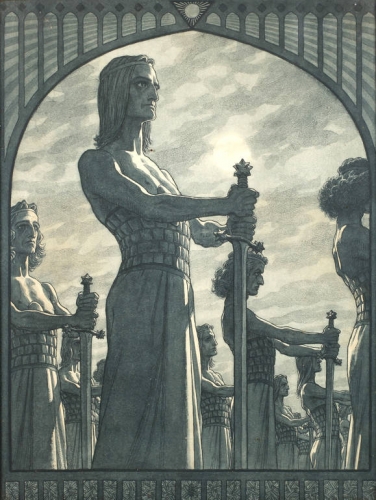
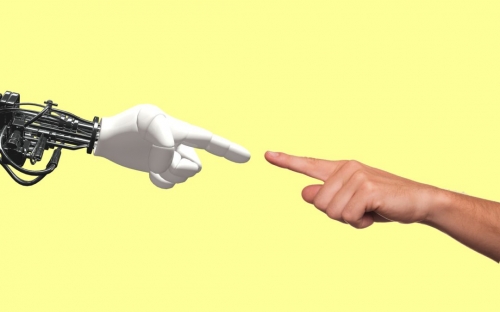

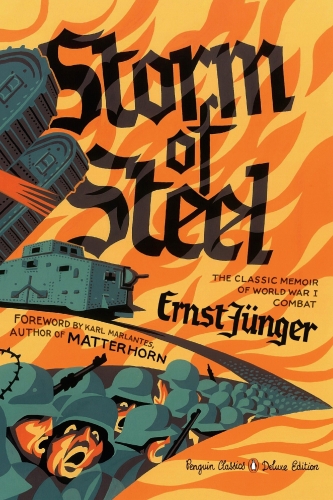 Embarrassés par un tel désastre, ces hommes "civilisés" ont dû faire face au fait que leur seule arme et leur seul espoir était la volonté, et leur seul monde les camarades du front. Derrière eux se cachaient les fiers idéaux des Lumières. Le jeu de la vie dans les bonnes formes et la rhétorique pamphlétaire parisienne étaient enfouis dans la boue de Verdun et de la Galice, dans les rochers du Carso et dans les eaux froides de la mer du Nord.
Embarrassés par un tel désastre, ces hommes "civilisés" ont dû faire face au fait que leur seule arme et leur seul espoir était la volonté, et leur seul monde les camarades du front. Derrière eux se cachaient les fiers idéaux des Lumières. Le jeu de la vie dans les bonnes formes et la rhétorique pamphlétaire parisienne étaient enfouis dans la boue de Verdun et de la Galice, dans les rochers du Carso et dans les eaux froides de la mer du Nord.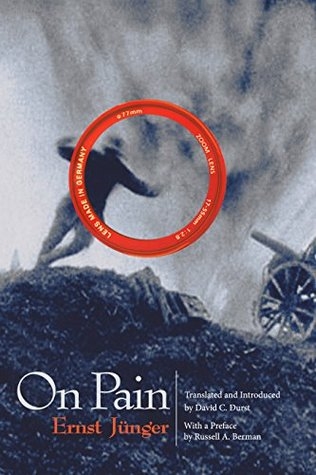 Jünger alla beaucoup plus loin ; il comprit que ce conflit avait détruit les barrières bourgeoises qui enseignaient l'existence comme une recherche de la réussite matérielle et l'observation de la morale sociale. C'est alors que les forces les plus profondes de la vie et de la réalité ont émergé lors du conflit, ce qu'il a appelé les "élémentaires", des forces qui, par une mobilisation totale, sont devenues une partie active de la nouvelle société, composée d'hommes jeunes et durs, une génération abyssalement différente de la précédente.
Jünger alla beaucoup plus loin ; il comprit que ce conflit avait détruit les barrières bourgeoises qui enseignaient l'existence comme une recherche de la réussite matérielle et l'observation de la morale sociale. C'est alors que les forces les plus profondes de la vie et de la réalité ont émergé lors du conflit, ce qu'il a appelé les "élémentaires", des forces qui, par une mobilisation totale, sont devenues une partie active de la nouvelle société, composée d'hommes jeunes et durs, une génération abyssalement différente de la précédente.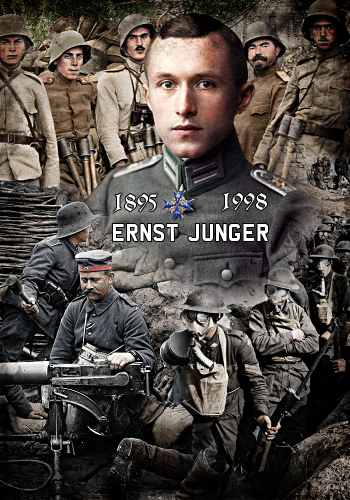
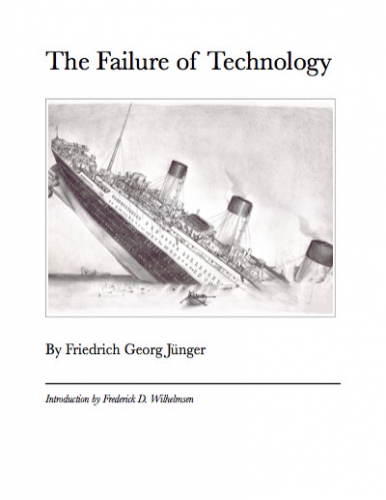 Au début des années 1930, une série d'écrivains sont apparus en Europe, surtout en Allemagne, dont les œuvres se référaient à la relation entre l'homme et la technique, où la volonté comme axe de la vie résulte en une constante. C'est le cas de L'homme et la technique d'Oswald Spengler - qui reprend les prémisses nietzschéennes de La volonté de puissance -, de la philosophie de la technique de Hans Freyer, de l’idée d’une perfection et de l'échec de la technique de Friedrich Georg Jünger - frère d'Ernst - et des séminaires du philosophe Martin Heidegger, tous contemporains du Travailleur, ouvrage précité. (Le livre de son frère Friedrich a été publié immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, mais il avait été écrit de nombreuses années auparavant et les vicissitudes du conflit l'ont empêché de voir le jour). Mais ces questions n'étaient pas uniquement du monde germanique, car il ne faut pas oublier les futuristes italiens dirigés par Filippo Marinetti, ni Luigi Pirandello de Manivelas, les écrits du Français Pierre Drieu La Rochelle - comme La Comédie de Charleroi - et le film Modern Times, de Charles Chaplin.
Au début des années 1930, une série d'écrivains sont apparus en Europe, surtout en Allemagne, dont les œuvres se référaient à la relation entre l'homme et la technique, où la volonté comme axe de la vie résulte en une constante. C'est le cas de L'homme et la technique d'Oswald Spengler - qui reprend les prémisses nietzschéennes de La volonté de puissance -, de la philosophie de la technique de Hans Freyer, de l’idée d’une perfection et de l'échec de la technique de Friedrich Georg Jünger - frère d'Ernst - et des séminaires du philosophe Martin Heidegger, tous contemporains du Travailleur, ouvrage précité. (Le livre de son frère Friedrich a été publié immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, mais il avait été écrit de nombreuses années auparavant et les vicissitudes du conflit l'ont empêché de voir le jour). Mais ces questions n'étaient pas uniquement du monde germanique, car il ne faut pas oublier les futuristes italiens dirigés par Filippo Marinetti, ni Luigi Pirandello de Manivelas, les écrits du Français Pierre Drieu La Rochelle - comme La Comédie de Charleroi - et le film Modern Times, de Charles Chaplin.
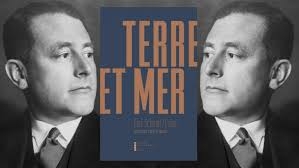


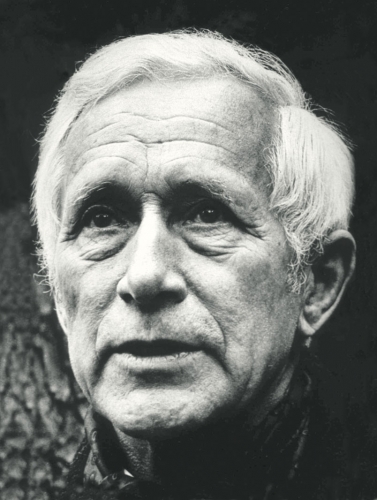

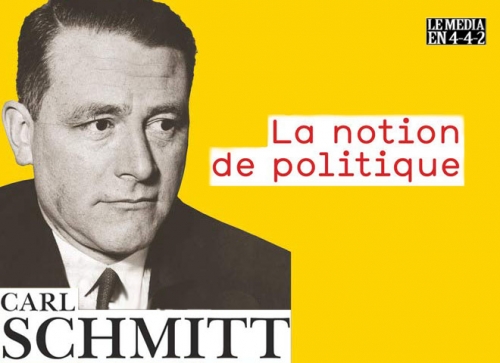


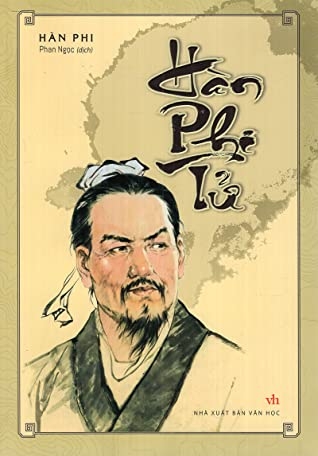 Par ailleurs, le contexte chinois est celui d'une culture dans laquelle l'école légaliste a agi en profondeur. Courant philosophique fondé au IIIe siècle avant J.-C. par Han Fei qui, en opposition aux idées confucéennes de bienveillance, de vertu et de respect des rituels, prêchait le droit du prince à exercer un pouvoir absolu et incontesté. Seule source du droit, le prince légaliste ne délègue aucune autorité à qui que ce soit. A côté de lui, il n'y a que des exécuteurs testamentaires, aux tâches strictement délimitées. En-dessous d'eux se trouvent les sujets, obligés seulement d'obéir.
Par ailleurs, le contexte chinois est celui d'une culture dans laquelle l'école légaliste a agi en profondeur. Courant philosophique fondé au IIIe siècle avant J.-C. par Han Fei qui, en opposition aux idées confucéennes de bienveillance, de vertu et de respect des rituels, prêchait le droit du prince à exercer un pouvoir absolu et incontesté. Seule source du droit, le prince légaliste ne délègue aucune autorité à qui que ce soit. A côté de lui, il n'y a que des exécuteurs testamentaires, aux tâches strictement délimitées. En-dessous d'eux se trouvent les sujets, obligés seulement d'obéir. Xi Jinping a redéfini le centre de gravité idéologique du parti communiste, redéfini la tolérance limitée de la dissidence, laquelle pouvait parfois se manifester mais a désormais disparu, de même toute forme d'autonomie, qui aurait pu être accordée au Xinjiang, à la Mongolie intérieure et à Hong Kong, a été supprimée.
Xi Jinping a redéfini le centre de gravité idéologique du parti communiste, redéfini la tolérance limitée de la dissidence, laquelle pouvait parfois se manifester mais a désormais disparu, de même toute forme d'autonomie, qui aurait pu être accordée au Xinjiang, à la Mongolie intérieure et à Hong Kong, a été supprimée.



 Carl Schmitt, dans le contexte de la République de Weimar plutôt que dans, celui, plus idéologique et polémique, de la révolution conservatrice, forge deux concepts à retenir : celui de la « décision » (Entscheidung), de la capacité et de la volonté de décider la politique à suivre (et même la guerre à mener) ; la « décision », avec la désignation de l’ennemi, sont dès lors les fondements même du politique, de l’essence du politique. La politique dans l’optique de Schmitt n’est constituée que par la gestion quotidienne et les débats sans grand relief des assemblées plus ou moins représentatives, en temps normaux. Quand il y a « état d’exception » ou « état d’urgence », quand la Cité est menacée, il faut décider, vite, sans débat, sans perte de temps. Ensuite, après avoir été sévèrement critiqué par des instances nationales-socialistes et s’être retiré de certains postes auxquels il avait été nommé, Schmitt a théorisé sa notion de « Grand Espace » (Grossraum), parallèlement à celles que formulaient à la même époque les diverses écoles de géopolitique actives en Allemagne, dont celle de Karl Haushofer. L’Europe, autour de son centre allemand, autour du territoire qui fut jadis celui du Saint-Empire Romain de la Nation Germanique, devait s’unir, gérer de concert son très grand appendice colonial africain et en interdire l’accès à toute puissance extérieure à ce double espace européen et africain. Pour Schmitt, c’était la notion de « Interventionsverbot raumfremder Mächte », visant à interdire toute intervention de puissances extérieures à l’espace européen dans l’espace européen et dans les espaces adjacents contrôlés par les Européens. Le modèle historique du raisonnement de Carl Schmitt, modèle en quelque sorte a contrario, était la proclamation en 1823 du Président américain Monroe qui posait comme axiome de la politique étrangère nord-américaine l’interdiction systématique de toute intervention européenne dans le Nouveau Monde, suite à l’éviction de l’Espagne hors de son empire ibéro-américain. Ne restaient présents en Amérique que les Russes en Alaska et en Californie (jusqu’en 1842) et les Britanniques au Canada. L’européisme grand-spatial de Schmitt complétait la vision triadique (Allemagne + Union Soviétique + Chine) des nationaux-révolutionnaires et nationaux-bolcheviques allemands. J’ai souligné, dans le principal essai du deuxième volume que j’ai consacré à la « révolution conservatrice », l’importance de cette volonté nationale-révolutionnaire de créer une vaste synergie germano-soviéto-chinoise dans les années 20 du siècle passé, jusqu’en 1933, année où les nationaux-socialistes s’installent dans tous les rouages du pouvoir. Le principal exposant de cette triade, eurasiste avant la lettre et avant la réanimation de ce concept par Alexandre Douguine en Russie actuelle, fut Richard Scheringer, dont la revue Aufbruch, disponible en facsimile, nous révèle des options géopolitiques et géostratégiques intéressantes qui ont, tout compte fait, un impact sur l’actualité. Les nationaux-révolutionnaires allemands entendaient prendre le pouvoir en Allemagne suite aux crises récurrentes que connaissait la République de Weimar ; pour eux, ces crises annonçaient une fin inévitable et catastrophique, générant un chaos passager auquel les anciens soldats de la Grande Guerre allaient mettre un terme, en renvoyant les politiciens falots dans leurs foyers ou… en règlant définitivement leur compte...
Carl Schmitt, dans le contexte de la République de Weimar plutôt que dans, celui, plus idéologique et polémique, de la révolution conservatrice, forge deux concepts à retenir : celui de la « décision » (Entscheidung), de la capacité et de la volonté de décider la politique à suivre (et même la guerre à mener) ; la « décision », avec la désignation de l’ennemi, sont dès lors les fondements même du politique, de l’essence du politique. La politique dans l’optique de Schmitt n’est constituée que par la gestion quotidienne et les débats sans grand relief des assemblées plus ou moins représentatives, en temps normaux. Quand il y a « état d’exception » ou « état d’urgence », quand la Cité est menacée, il faut décider, vite, sans débat, sans perte de temps. Ensuite, après avoir été sévèrement critiqué par des instances nationales-socialistes et s’être retiré de certains postes auxquels il avait été nommé, Schmitt a théorisé sa notion de « Grand Espace » (Grossraum), parallèlement à celles que formulaient à la même époque les diverses écoles de géopolitique actives en Allemagne, dont celle de Karl Haushofer. L’Europe, autour de son centre allemand, autour du territoire qui fut jadis celui du Saint-Empire Romain de la Nation Germanique, devait s’unir, gérer de concert son très grand appendice colonial africain et en interdire l’accès à toute puissance extérieure à ce double espace européen et africain. Pour Schmitt, c’était la notion de « Interventionsverbot raumfremder Mächte », visant à interdire toute intervention de puissances extérieures à l’espace européen dans l’espace européen et dans les espaces adjacents contrôlés par les Européens. Le modèle historique du raisonnement de Carl Schmitt, modèle en quelque sorte a contrario, était la proclamation en 1823 du Président américain Monroe qui posait comme axiome de la politique étrangère nord-américaine l’interdiction systématique de toute intervention européenne dans le Nouveau Monde, suite à l’éviction de l’Espagne hors de son empire ibéro-américain. Ne restaient présents en Amérique que les Russes en Alaska et en Californie (jusqu’en 1842) et les Britanniques au Canada. L’européisme grand-spatial de Schmitt complétait la vision triadique (Allemagne + Union Soviétique + Chine) des nationaux-révolutionnaires et nationaux-bolcheviques allemands. J’ai souligné, dans le principal essai du deuxième volume que j’ai consacré à la « révolution conservatrice », l’importance de cette volonté nationale-révolutionnaire de créer une vaste synergie germano-soviéto-chinoise dans les années 20 du siècle passé, jusqu’en 1933, année où les nationaux-socialistes s’installent dans tous les rouages du pouvoir. Le principal exposant de cette triade, eurasiste avant la lettre et avant la réanimation de ce concept par Alexandre Douguine en Russie actuelle, fut Richard Scheringer, dont la revue Aufbruch, disponible en facsimile, nous révèle des options géopolitiques et géostratégiques intéressantes qui ont, tout compte fait, un impact sur l’actualité. Les nationaux-révolutionnaires allemands entendaient prendre le pouvoir en Allemagne suite aux crises récurrentes que connaissait la République de Weimar ; pour eux, ces crises annonçaient une fin inévitable et catastrophique, générant un chaos passager auquel les anciens soldats de la Grande Guerre allaient mettre un terme, en renvoyant les politiciens falots dans leurs foyers ou… en règlant définitivement leur compte...
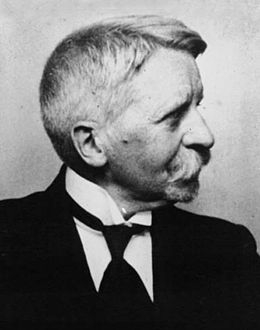 Finalement, dans le contexte de la nouvelle droite française, ce seront surtout Ernst Jünger et Oswald Spengler qui seront sollicités, parce qu’ils ont été très tôt et abondamment traduits en langue française. A cette réception de Spengler et, principalement, de Jünger, il faut ajouter un impact très important du filon nietzschéen français, né avant la première guerre mondiale, sous la notable impulsion de Charles Andler (1866-1933), Strasbourgeois de naissance, auteur de trois volumes sur la réception de Nietzsche en France. Charles Andler était socialiste, membre fondateur du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, fondé en 1889. Il avait correspondu avec Engels, définissait sa position comme « humaniste et travailliste » mais, comme la référence à Nietzsche avant 1914 était davantage socialiste que conservatrice, il se rend en Allemagne en 1904 pour rencontrer la sœur de Nietzsche et en Suisse, à Bâle, en 1907 pour prendre conseil auprès du premier grand spécialiste de la pensée nietzschéenne, Carl Albrecht Bernoulli (1868-1937), élève de l’ami de Nietzsche, Franz Camille Overbeck (1837-1905). Son triple positionnement politique, socialiste, dreyfusard et nietzschéen, suscite l’hostilité virulente de l’Action Française, principale porte-voix de la droite nationaliste à l’époque. Pourtant, Andler n’était pas un Alsacien germanophile : pendant la première guerre mondiale, il crée diverses structures visant la réintégration de l’Alsace dans la République française.
Finalement, dans le contexte de la nouvelle droite française, ce seront surtout Ernst Jünger et Oswald Spengler qui seront sollicités, parce qu’ils ont été très tôt et abondamment traduits en langue française. A cette réception de Spengler et, principalement, de Jünger, il faut ajouter un impact très important du filon nietzschéen français, né avant la première guerre mondiale, sous la notable impulsion de Charles Andler (1866-1933), Strasbourgeois de naissance, auteur de trois volumes sur la réception de Nietzsche en France. Charles Andler était socialiste, membre fondateur du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, fondé en 1889. Il avait correspondu avec Engels, définissait sa position comme « humaniste et travailliste » mais, comme la référence à Nietzsche avant 1914 était davantage socialiste que conservatrice, il se rend en Allemagne en 1904 pour rencontrer la sœur de Nietzsche et en Suisse, à Bâle, en 1907 pour prendre conseil auprès du premier grand spécialiste de la pensée nietzschéenne, Carl Albrecht Bernoulli (1868-1937), élève de l’ami de Nietzsche, Franz Camille Overbeck (1837-1905). Son triple positionnement politique, socialiste, dreyfusard et nietzschéen, suscite l’hostilité virulente de l’Action Française, principale porte-voix de la droite nationaliste à l’époque. Pourtant, Andler n’était pas un Alsacien germanophile : pendant la première guerre mondiale, il crée diverses structures visant la réintégration de l’Alsace dans la République française.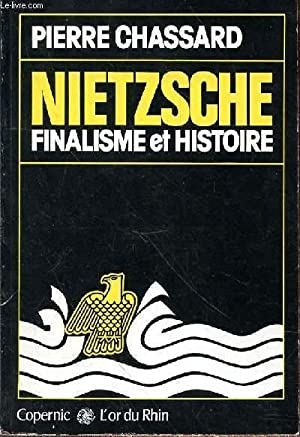 Nous nous trouvons dès lors devant quelques beaux paradoxes : la « nouvelle droite », qui se revendique « nietzschéenne » par hostilité au christianisme en général et au catholicisme tiers-mondiste en vogue depuis Vatican II en particulier, ne prend pas en compte le nietzschéisme français (et allemand) original qui se situait à gauche de l’échiquier politique de la Troisième République et du Reich wilhelminien, alors que les positions prises en son temps par Andler sur l’œuvre de Nietzsche correspondent presque exactement à celles que la « nouvelle droite » entend défendre aujourd’hui, parce qu’elle a abandonné ses options premières anti-égalitaristes et favorables aux droites giscardiennes et chiraquiennes des années 1970 et 1980.
Nous nous trouvons dès lors devant quelques beaux paradoxes : la « nouvelle droite », qui se revendique « nietzschéenne » par hostilité au christianisme en général et au catholicisme tiers-mondiste en vogue depuis Vatican II en particulier, ne prend pas en compte le nietzschéisme français (et allemand) original qui se situait à gauche de l’échiquier politique de la Troisième République et du Reich wilhelminien, alors que les positions prises en son temps par Andler sur l’œuvre de Nietzsche correspondent presque exactement à celles que la « nouvelle droite » entend défendre aujourd’hui, parce qu’elle a abandonné ses options premières anti-égalitaristes et favorables aux droites giscardiennes et chiraquiennes des années 1970 et 1980.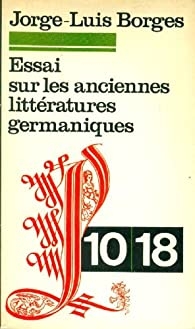 La nécessité de l’ancrage classique, je la dois au professeur de latin, l’Abbé Simon Hauwaert, qui avait bien conscience que les humanités gréco-latines, auxquelles il tenait comme à la prunelle de ses yeux, devait être consolidées par un savoir mythologique et archéologique sur les mondes germaniques et celtiques. C’est ainsi que j’ai lu le celtologue Jean Markale sur les matières irlandaises, galloises et bretonnes. Pour l’initiation du collégien au monde mythologique germanique, je la dois à un petit livre que je conseille toujours vivement, dû à la plume de l’Argentin Jorge Luis Borgès, Essai sur les anciennes littératures germaniques. Ce petit savoir initial, complété par un bref cours scolaire sur les origines de la littérature néerlandaise, nous posait, dans les années 70, comme des contestataires inébranlables du désordre officiel qui s’installait en effaçant tous les legs de notre histoire et de notre culture.
La nécessité de l’ancrage classique, je la dois au professeur de latin, l’Abbé Simon Hauwaert, qui avait bien conscience que les humanités gréco-latines, auxquelles il tenait comme à la prunelle de ses yeux, devait être consolidées par un savoir mythologique et archéologique sur les mondes germaniques et celtiques. C’est ainsi que j’ai lu le celtologue Jean Markale sur les matières irlandaises, galloises et bretonnes. Pour l’initiation du collégien au monde mythologique germanique, je la dois à un petit livre que je conseille toujours vivement, dû à la plume de l’Argentin Jorge Luis Borgès, Essai sur les anciennes littératures germaniques. Ce petit savoir initial, complété par un bref cours scolaire sur les origines de la littérature néerlandaise, nous posait, dans les années 70, comme des contestataires inébranlables du désordre officiel qui s’installait en effaçant tous les legs de notre histoire et de notre culture.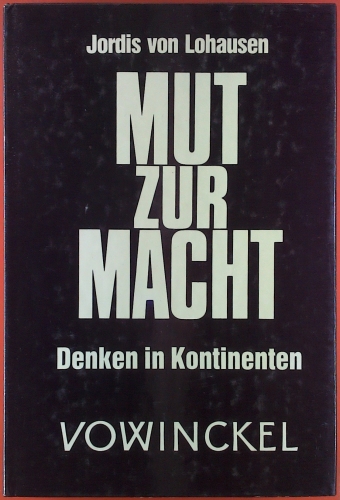
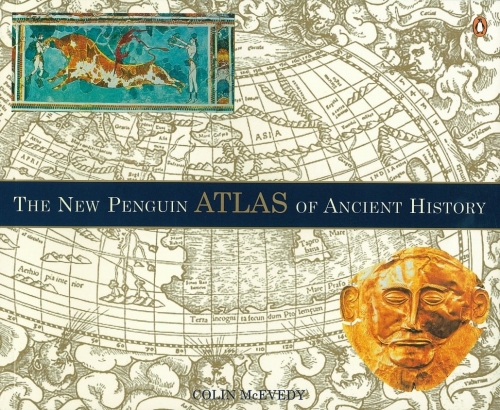
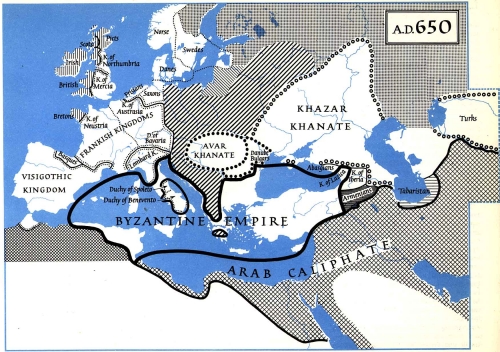
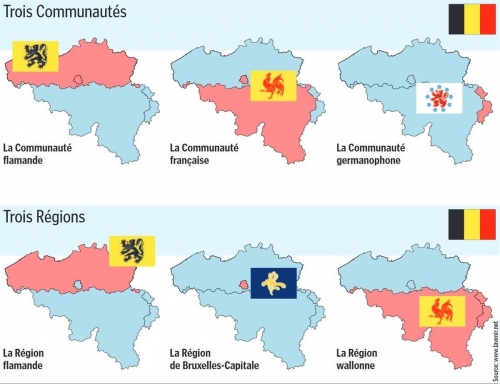
 Après 1918 et jusqu’à la débâcle belge de mai 1940, une figure intellectuelle de haut niveau a donné au socialisme belge ses lettres de noblesse en la personne de Hendrik de Man, théoricien d’un socialisme personnaliste qui a inspiré considérablement les théoriciens et activistes français que l’on regroupe, par commodité, sous l’étiquette de « non-conformistes des années 30 ». D’aucuns font de ces « non-conformistes » les équivalents des « révolutionnaires conservateurs » allemands. Après 1945, le socialisme, comme partout en Europe occidentale, a servi de cheval de Troie aux stratégies de l’OTAN, les Américains, dans les années 40 et 50, préférant miser sur les sociaux-démocrates plutôt que sur les chrétiens-démocrates ou sur les conservateurs. Plus tard, sous l’influence des « nouvelles gauches » et de l’esprit soixante-huitard, le socialisme, comme en France et ailleurs, a préféré parier sur de nouvelles strates sociales, posées comme défavorisées ou discriminées, et a adopté les modes que feu le philosophe Philippe Muray nommait « festivistes ». Il a délaissé la classe ouvrière et, même, plus largement, l’ensemble des familles actives dans des fonctions sociales concrètes. Avec les engouements LGBT (etc.), les combats concrets pour la classe ouvrière ont été oubliés, provoquant une hémorragie électorale au bénéfice des rigolos qui se disent écologistes et surtout d’un néo-communisme plus virulent, celui du PTB (« Parti du Travail de Belgique »), qui entend, à juste titre, défendre les acquis sociaux des classes travailleuses, acquis qui avaient été exemplaires dans la Belgique d’antan. En Flandre, la classe ouvrière a généralement (mais pas complètement) préféré le nationalisme classé à droite mais aux discours plus populistes.
Après 1918 et jusqu’à la débâcle belge de mai 1940, une figure intellectuelle de haut niveau a donné au socialisme belge ses lettres de noblesse en la personne de Hendrik de Man, théoricien d’un socialisme personnaliste qui a inspiré considérablement les théoriciens et activistes français que l’on regroupe, par commodité, sous l’étiquette de « non-conformistes des années 30 ». D’aucuns font de ces « non-conformistes » les équivalents des « révolutionnaires conservateurs » allemands. Après 1945, le socialisme, comme partout en Europe occidentale, a servi de cheval de Troie aux stratégies de l’OTAN, les Américains, dans les années 40 et 50, préférant miser sur les sociaux-démocrates plutôt que sur les chrétiens-démocrates ou sur les conservateurs. Plus tard, sous l’influence des « nouvelles gauches » et de l’esprit soixante-huitard, le socialisme, comme en France et ailleurs, a préféré parier sur de nouvelles strates sociales, posées comme défavorisées ou discriminées, et a adopté les modes que feu le philosophe Philippe Muray nommait « festivistes ». Il a délaissé la classe ouvrière et, même, plus largement, l’ensemble des familles actives dans des fonctions sociales concrètes. Avec les engouements LGBT (etc.), les combats concrets pour la classe ouvrière ont été oubliés, provoquant une hémorragie électorale au bénéfice des rigolos qui se disent écologistes et surtout d’un néo-communisme plus virulent, celui du PTB (« Parti du Travail de Belgique »), qui entend, à juste titre, défendre les acquis sociaux des classes travailleuses, acquis qui avaient été exemplaires dans la Belgique d’antan. En Flandre, la classe ouvrière a généralement (mais pas complètement) préféré le nationalisme classé à droite mais aux discours plus populistes.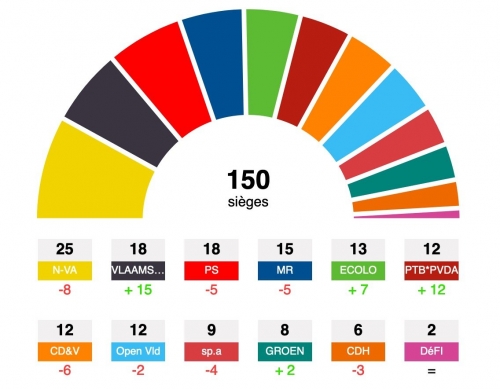
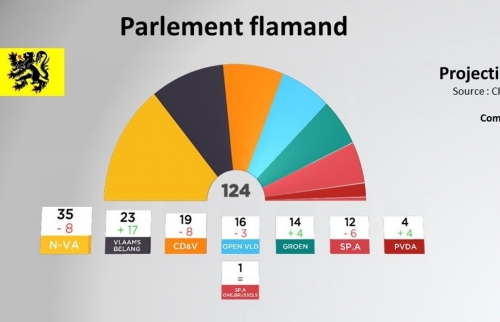


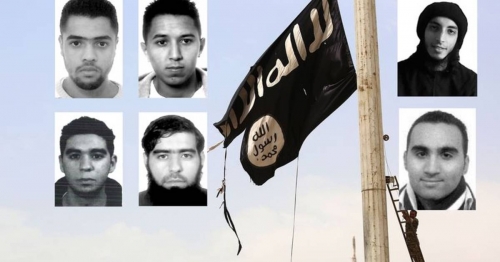




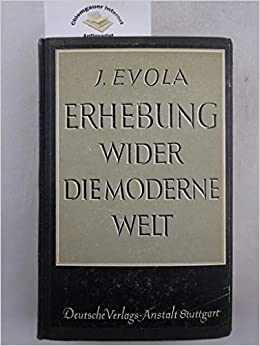 Julius Evola n'était ni "fasciste" ni "antifasciste" (comme il l'écrivait de façon polémique dans sa revue bimensuelle "La Torre" au début de 1930), et par conséquent il n'était ni "nazi" ni "anti-nazi" : était-il alors un incertain, un attentiste, un hypocrite, un - comme on le dit en Italie - "un poisson dans un tonneau" ? Non: il a accepté les idées, les thèses, les positions, les attitudes et les choix pratiques du fascisme, et donc du nazisme, qui étaient en accord avec ceux d'une droite traditionnelle et, plus tard, de ce que l'on a appelé la révolution conservatrice allemande. Une vision qui était à l'époque gibeline, impériale, aristocratique, qui - même si elle est "utopique" - l'éloignait certes de la Weltanschauung populiste "démocratique" et "plébéienne" du fascisme mais surtout du nazisme, dont le matérialisme biologique lui était totalement insupportable. Il ne s'agit pas de justifications a posteriori, comme quelqu'un l'a malicieusement pensé en lisant les pages de Il cammino del cinabro (1963), car Evola n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un "repenti" : il n'a jamais rien répudié ni rejeté de son passé ; même s'il a rectifié et pris ses distances par rapport à certaines de ses positions de jeunesse (tout le monde oublie ce qu'il a écrit sur l'impérialisme païen en 1928 : "Dans le livre, dans la mesure où il suivait - je dois le reconnaître - l'impulsion d'une pensée radicaliste faisant usage d'un style violent, il était typique d’une absence juvénile de mesure et de sens politique et à une utopique inconscience de l'état des choses" : non pas "le repentir" mais la maturation logique d'un homme de pensée). Le fait que ce ne sont pas des justifications est démontré par les documents qui, au fil des ans, après sa mort en 1974, sont lentement apparus dans les archives publiques et privées italiennes et allemandes. D'eux émerge un Julius Evola qui était tout sauf "organique au régime" comme on l'a écrit, mais même pas aussi marginal qu'on le croyait : un essayiste, journaliste, polémiste, conférencier, qui a connu des hauts et des bas et qui, après la crise de 1930 avec l’interdiction de "La Torre" et sa marginalisation, a accepté de se rapprocher de personnalités comme Giovanni Preziosi, Roberto Farinacci, Italo Balbo, c'est-à-dire, on pourrait dire, les fascistes les plus "révolutionnaires" et les plus "intransigeants", afin d'exprimer ses idées critiques à l'abri de ces niches, agissant comme une sorte de "cinquième colonne" traditionaliste pour tenter l'entreprise utopique de "rectifier" le Régime dans ce sens : Il commence donc à écrire à partir de mars 1931 dans "La Vita Italiana", à partir de janvier 1933 dans "Il Corriere Padano" et "Il Regine Fascista", puis - sortant du "ghetto" des disgraciés - à partir d'avril 1933 dans "La Rassegna Italiana", à partir de février 1934 dans la revue d’inspiration autoritaire "Lo Stato" et dans "Roma", à partir de mars 1934 dans "Bibliografia Fascista".
Julius Evola n'était ni "fasciste" ni "antifasciste" (comme il l'écrivait de façon polémique dans sa revue bimensuelle "La Torre" au début de 1930), et par conséquent il n'était ni "nazi" ni "anti-nazi" : était-il alors un incertain, un attentiste, un hypocrite, un - comme on le dit en Italie - "un poisson dans un tonneau" ? Non: il a accepté les idées, les thèses, les positions, les attitudes et les choix pratiques du fascisme, et donc du nazisme, qui étaient en accord avec ceux d'une droite traditionnelle et, plus tard, de ce que l'on a appelé la révolution conservatrice allemande. Une vision qui était à l'époque gibeline, impériale, aristocratique, qui - même si elle est "utopique" - l'éloignait certes de la Weltanschauung populiste "démocratique" et "plébéienne" du fascisme mais surtout du nazisme, dont le matérialisme biologique lui était totalement insupportable. Il ne s'agit pas de justifications a posteriori, comme quelqu'un l'a malicieusement pensé en lisant les pages de Il cammino del cinabro (1963), car Evola n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un "repenti" : il n'a jamais rien répudié ni rejeté de son passé ; même s'il a rectifié et pris ses distances par rapport à certaines de ses positions de jeunesse (tout le monde oublie ce qu'il a écrit sur l'impérialisme païen en 1928 : "Dans le livre, dans la mesure où il suivait - je dois le reconnaître - l'impulsion d'une pensée radicaliste faisant usage d'un style violent, il était typique d’une absence juvénile de mesure et de sens politique et à une utopique inconscience de l'état des choses" : non pas "le repentir" mais la maturation logique d'un homme de pensée). Le fait que ce ne sont pas des justifications est démontré par les documents qui, au fil des ans, après sa mort en 1974, sont lentement apparus dans les archives publiques et privées italiennes et allemandes. D'eux émerge un Julius Evola qui était tout sauf "organique au régime" comme on l'a écrit, mais même pas aussi marginal qu'on le croyait : un essayiste, journaliste, polémiste, conférencier, qui a connu des hauts et des bas et qui, après la crise de 1930 avec l’interdiction de "La Torre" et sa marginalisation, a accepté de se rapprocher de personnalités comme Giovanni Preziosi, Roberto Farinacci, Italo Balbo, c'est-à-dire, on pourrait dire, les fascistes les plus "révolutionnaires" et les plus "intransigeants", afin d'exprimer ses idées critiques à l'abri de ces niches, agissant comme une sorte de "cinquième colonne" traditionaliste pour tenter l'entreprise utopique de "rectifier" le Régime dans ce sens : Il commence donc à écrire à partir de mars 1931 dans "La Vita Italiana", à partir de janvier 1933 dans "Il Corriere Padano" et "Il Regine Fascista", puis - sortant du "ghetto" des disgraciés - à partir d'avril 1933 dans "La Rassegna Italiana", à partir de février 1934 dans la revue d’inspiration autoritaire "Lo Stato" et dans "Roma", à partir de mars 1934 dans "Bibliografia Fascista".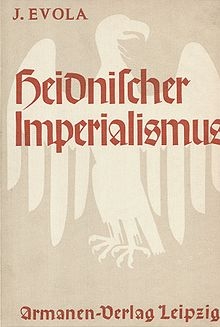 Une adhésion très critique, donc, celle de Julius Evola, de manière à ne pas pouvoir le définir de manière simpliste ni comme un "fasciste", ni comme un "nazi" de droit. Son point de référence était plutôt la Révolution conservatrice et ses représentants de l'époque. Écoutons ses propres mots extraits de Le Chemin du Cinabre : "Déjà l'édition allemande de mon Impérialisme païen, où les idées de base avaient été détachées des références italiennes, avait fait connaître mon nom en Allemagne dans les cercles maintenant connus. En 1934, j'ai fait mon premier voyage dans le nord, pour donner une conférence dans une université de Berlin, une deuxième conférence à Brême dans le cadre d'une conférence internationale sur les études nordiques (le deuxième Nordisches Thing, parrainée par Roselius), et, surtout, un discours pour un petit groupe du Herrenklub de Berlin, le cercle de la noblesse allemande conservatrice dont on connaît la part importante dans la politique allemande plus récente. C'est ici que j'ai trouvé mon environnement naturel. Dès lors, une amitié cordiale et fructueuse s'est établie entre moi et le président du cercle, le baron Heinrich von Gleichen. Les idées que j'ai défendues ont trouvé un terrain propice à la compréhension et à l'évaluation des problèmes de l’époque. Et c'est également sur cette base qu'une de mes activités a été menée en Allemagne, suite à une convergence d'intérêts et d'objectifs".
Une adhésion très critique, donc, celle de Julius Evola, de manière à ne pas pouvoir le définir de manière simpliste ni comme un "fasciste", ni comme un "nazi" de droit. Son point de référence était plutôt la Révolution conservatrice et ses représentants de l'époque. Écoutons ses propres mots extraits de Le Chemin du Cinabre : "Déjà l'édition allemande de mon Impérialisme païen, où les idées de base avaient été détachées des références italiennes, avait fait connaître mon nom en Allemagne dans les cercles maintenant connus. En 1934, j'ai fait mon premier voyage dans le nord, pour donner une conférence dans une université de Berlin, une deuxième conférence à Brême dans le cadre d'une conférence internationale sur les études nordiques (le deuxième Nordisches Thing, parrainée par Roselius), et, surtout, un discours pour un petit groupe du Herrenklub de Berlin, le cercle de la noblesse allemande conservatrice dont on connaît la part importante dans la politique allemande plus récente. C'est ici que j'ai trouvé mon environnement naturel. Dès lors, une amitié cordiale et fructueuse s'est établie entre moi et le président du cercle, le baron Heinrich von Gleichen. Les idées que j'ai défendues ont trouvé un terrain propice à la compréhension et à l'évaluation des problèmes de l’époque. Et c'est également sur cette base qu'une de mes activités a été menée en Allemagne, suite à une convergence d'intérêts et d'objectifs".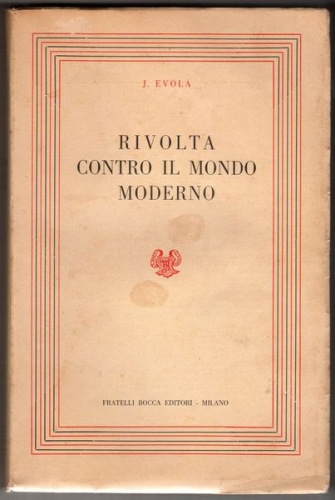 Il manque encore des études complètes sur une initiative qui était unique dans la période fasciste en termes d'intentions et de complexité : un véritable projet culturel avec lequel Julius Evola entendait exposer de manière constructive et critique le point de vue de la droite traditionnelle et conservatrice par rapport au fascisme. De nombreux représentants officiels de la culture européenne de cette tendance ont écrit sur cette page : des Italiens, mais aussi des Allemands, des Autrichiens, des Français et des Anglais. Parmi les Allemands, il y avait aussi le médecin et poète Gottfried Benn, avec lequel Evola correspondait depuis 1930.
Il manque encore des études complètes sur une initiative qui était unique dans la période fasciste en termes d'intentions et de complexité : un véritable projet culturel avec lequel Julius Evola entendait exposer de manière constructive et critique le point de vue de la droite traditionnelle et conservatrice par rapport au fascisme. De nombreux représentants officiels de la culture européenne de cette tendance ont écrit sur cette page : des Italiens, mais aussi des Allemands, des Autrichiens, des Français et des Anglais. Parmi les Allemands, il y avait aussi le médecin et poète Gottfried Benn, avec lequel Evola correspondait depuis 1930.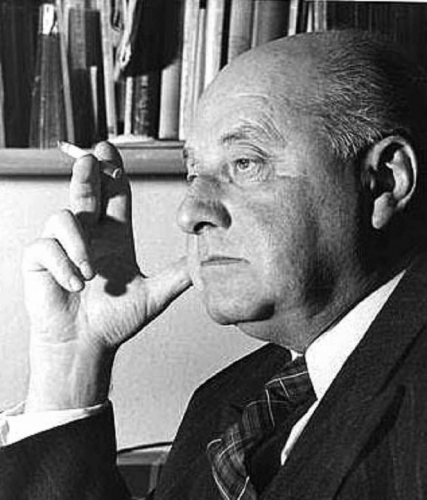

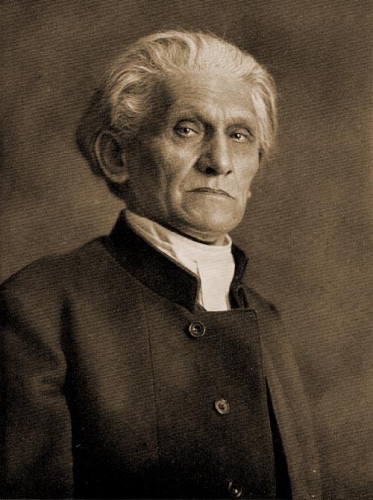
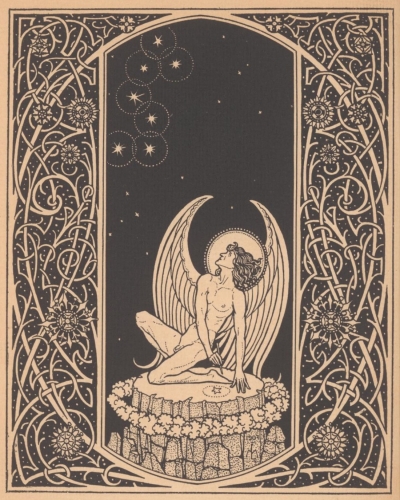
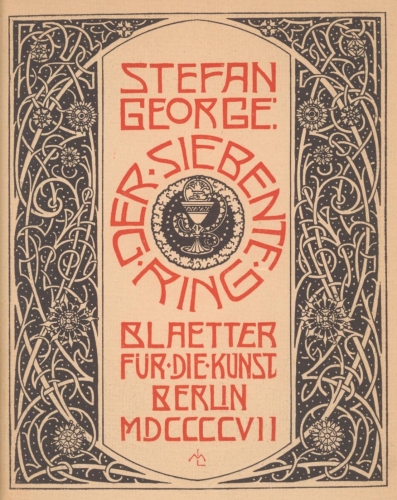
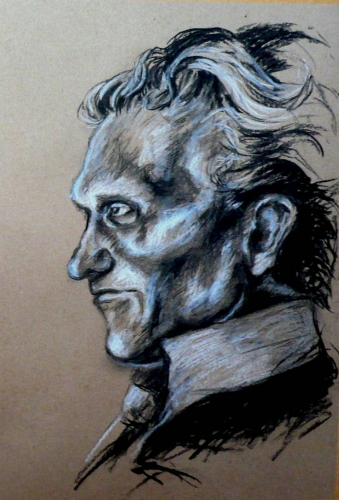
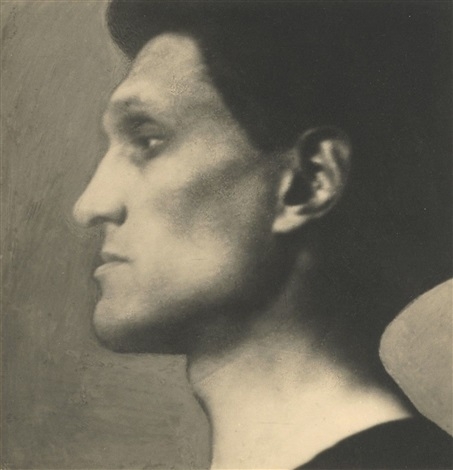
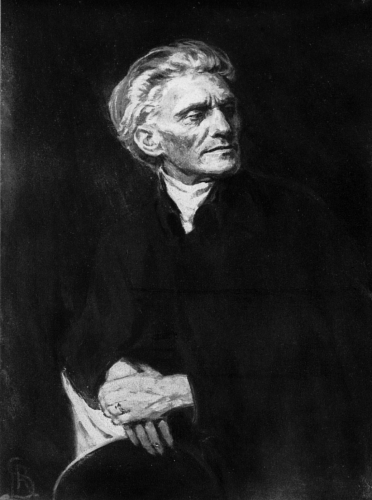
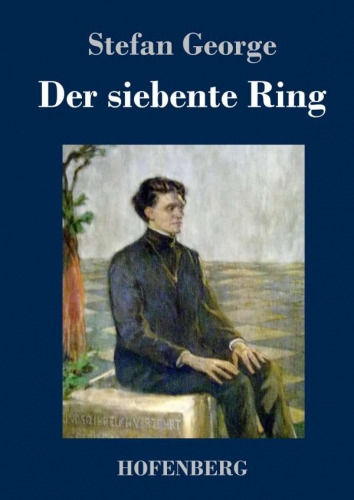
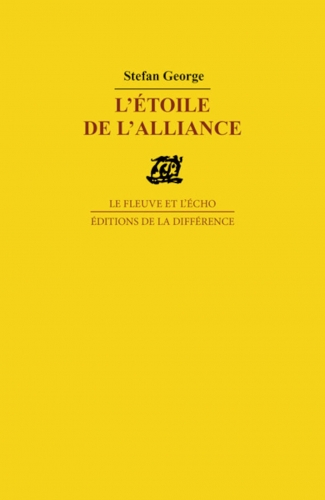


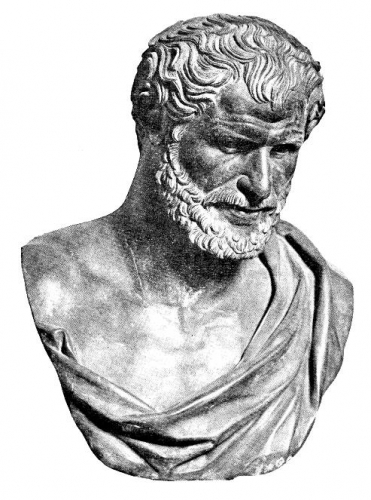 Dans le contexte islamique, puisque la révélation y est à la fois prophétie et loi, le sens réel du terme conflit utilisé par Héraclite apparaît avec toute sa force perturbatrice dans le concept théologique de djihad. Cela, rappelons-le, signifie littéralement "effort" et indique l'engagement de l'homme à s'améliorer, à devenir un "vrai" être humain, paraphrasant l'interprétation qu'en donne l'imam Khomeiny [2].
Dans le contexte islamique, puisque la révélation y est à la fois prophétie et loi, le sens réel du terme conflit utilisé par Héraclite apparaît avec toute sa force perturbatrice dans le concept théologique de djihad. Cela, rappelons-le, signifie littéralement "effort" et indique l'engagement de l'homme à s'améliorer, à devenir un "vrai" être humain, paraphrasant l'interprétation qu'en donne l'imam Khomeiny [2].
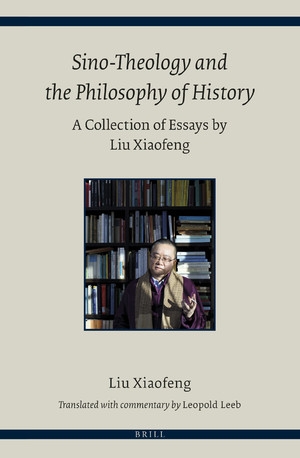 Dans ce contexte, selon l'historien et homme politique Liang Qichao, qui a vécu au tournant des XIXe et XXe siècles à l'époque du déclin inexorable et de la partition impérialiste de l'espace chinois, la solution ne pouvait être que la création d'une forme de nationalisme chinois. Cependant, ce que Qichao considérait comme du nationalisme était une forme de conscience politique et culturelle nationale, mais pas du nationalisme au sens européen du terme. En fait, ce concept est resté complètement étranger à la forme impériale traditionnelle qui, même aujourd'hui, dans son expression modernisée et influencée par le marxisme-léninisme, ressemble davantage au modèle achéménide qu'à l'idée européenne de l'État-nation et de ses impulsions impérialistes. Et, en tant que telle, elle s'est imposée dès son origine comme un dépassement en nuance de cette idée.
Dans ce contexte, selon l'historien et homme politique Liang Qichao, qui a vécu au tournant des XIXe et XXe siècles à l'époque du déclin inexorable et de la partition impérialiste de l'espace chinois, la solution ne pouvait être que la création d'une forme de nationalisme chinois. Cependant, ce que Qichao considérait comme du nationalisme était une forme de conscience politique et culturelle nationale, mais pas du nationalisme au sens européen du terme. En fait, ce concept est resté complètement étranger à la forme impériale traditionnelle qui, même aujourd'hui, dans son expression modernisée et influencée par le marxisme-léninisme, ressemble davantage au modèle achéménide qu'à l'idée européenne de l'État-nation et de ses impulsions impérialistes. Et, en tant que telle, elle s'est imposée dès son origine comme un dépassement en nuance de cette idée.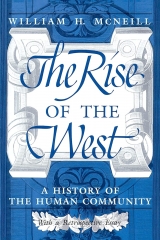 Ainsi, l'histoire mondiale n'a été que la superstructure historiographique du libéralisme occidental à l'époque de la guerre froide et de l'instant unipolaire.
Ainsi, l'histoire mondiale n'a été que la superstructure historiographique du libéralisme occidental à l'époque de la guerre froide et de l'instant unipolaire.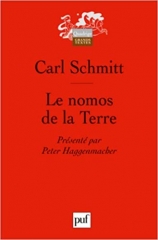 Les États-Unis sont nés dans un "espace libre" où prévalait la loi du plus fort, celle de l'état de nature et sur le fond idéologico-religieux du thème biblique de l'Exode et de la conviction messianique de la construction du "Nouvel Israël" et de la "Jérusalem sur terre" : des principes qui sont à la base de l'idée puritaine de supériorité morale et de prédestination et qui représentent les fondements existentiels de l'américanisme. Les États-Unis sont nés en totale opposition au modèle européen. Leur entrée sur le Vieux Continent marque le passage de la guerre "légale" à la guerre "idéologique" : l'ennemi doit non seulement être vaincu, mais diabolisé, criminalisé et donc anéanti. Ce que les États-Unis ont fait, c'est ramener en Europe la loi du plus fort, en la considérant, comme les Européens l'avaient fait avec l'hémisphère occidental à l'époque moderne, comme un "espace libre" à soumettre à la simple conquête.
Les États-Unis sont nés dans un "espace libre" où prévalait la loi du plus fort, celle de l'état de nature et sur le fond idéologico-religieux du thème biblique de l'Exode et de la conviction messianique de la construction du "Nouvel Israël" et de la "Jérusalem sur terre" : des principes qui sont à la base de l'idée puritaine de supériorité morale et de prédestination et qui représentent les fondements existentiels de l'américanisme. Les États-Unis sont nés en totale opposition au modèle européen. Leur entrée sur le Vieux Continent marque le passage de la guerre "légale" à la guerre "idéologique" : l'ennemi doit non seulement être vaincu, mais diabolisé, criminalisé et donc anéanti. Ce que les États-Unis ont fait, c'est ramener en Europe la loi du plus fort, en la considérant, comme les Européens l'avaient fait avec l'hémisphère occidental à l'époque moderne, comme un "espace libre" à soumettre à la simple conquête.

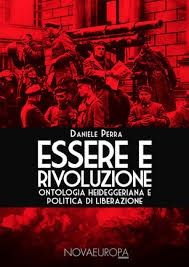 NOTES
NOTES
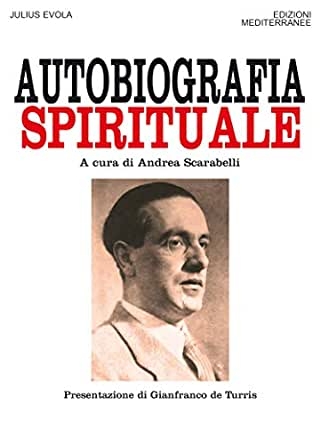 Tout cela est très révélateur de l'influence de la culture allemande sur l'œuvre d'Evola. Mais il faut ajouter d'autres données : en rappelant ici ce qui a été mentionné dans la biographie d’Evola, au premier chapitre, je me souviens de l’évocation des longs séjours d'Evola en Autriche et en Allemagne, des nombreuses conférences qui s'y sont tenues, de ses relations avec les représentants de la tradition aristocratique et conservatrice d'Europe centrale et de la révolution conservatrice, etc. En outre, dans les pays germanophones, Evola jouissait, au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une notoriété différente de celle qu'il avait en Italie, car il y fut reçu comme l'exposant d'un courant particulier de la pensée italienne, et cela depuis 1933, année de la publication de Heidnischer Imperialismus. Voici l'opinion d'Adriano Romualdi sur le sujet : "L'action d'Evola en Allemagne n'était pas politique, même si elle a contribué à dissiper de nombreux malentendus et à préparer une entente entre le fascisme et le national-socialisme. Elle a investi le sens de ces traditions qui, en Italie et en Allemagne, ont été évoquées par les régimes, comme le symbole romain et le mythe nordique, le sens du classicisme et du romantisme, ou des oppositions artificielles, comme celle entre la romanité et le germanisme".
Tout cela est très révélateur de l'influence de la culture allemande sur l'œuvre d'Evola. Mais il faut ajouter d'autres données : en rappelant ici ce qui a été mentionné dans la biographie d’Evola, au premier chapitre, je me souviens de l’évocation des longs séjours d'Evola en Autriche et en Allemagne, des nombreuses conférences qui s'y sont tenues, de ses relations avec les représentants de la tradition aristocratique et conservatrice d'Europe centrale et de la révolution conservatrice, etc. En outre, dans les pays germanophones, Evola jouissait, au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une notoriété différente de celle qu'il avait en Italie, car il y fut reçu comme l'exposant d'un courant particulier de la pensée italienne, et cela depuis 1933, année de la publication de Heidnischer Imperialismus. Voici l'opinion d'Adriano Romualdi sur le sujet : "L'action d'Evola en Allemagne n'était pas politique, même si elle a contribué à dissiper de nombreux malentendus et à préparer une entente entre le fascisme et le national-socialisme. Elle a investi le sens de ces traditions qui, en Italie et en Allemagne, ont été évoquées par les régimes, comme le symbole romain et le mythe nordique, le sens du classicisme et du romantisme, ou des oppositions artificielles, comme celle entre la romanité et le germanisme".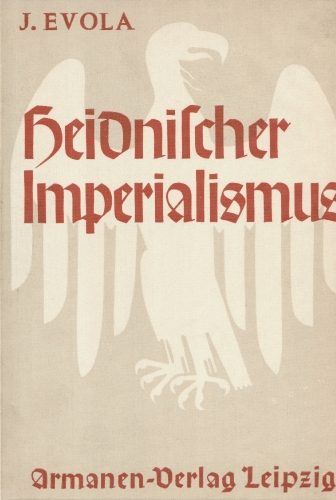
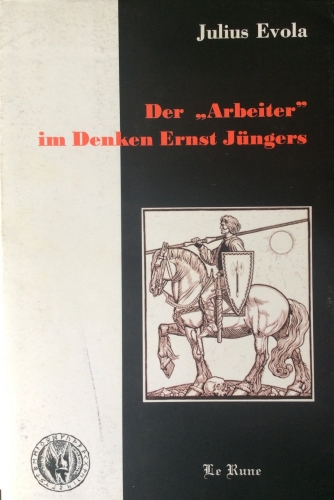
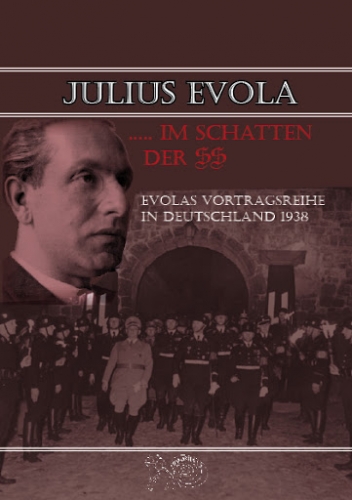 Mais les différences, du point de vue de l’environnement, sont beaucoup plus marquées. Dans son essai sur le Troisième Reich, qui décrit les courants culturels complexes et souvent irréductibles qui ont coopéré à sa genèse, Evola écrit : "Après la Première Guerre mondiale, la situation en Allemagne était nettement différente de celle de l'Italie. [...] Mussolini a dû créer presque tout à partir de rien, en ce sens qu'au moment de combattre la subversion rouge et de remettre l'État sur pied, il ne pouvait pas se référer à une tradition au sens le plus élevé du terme. Tout bien considéré, ce qui était menacé n'était que l'extension de l'Italie démocratique du XIXe siècle, avec un héritage du Risorgimento influencé par les idéologies de la Révolution française, avec une monarchie qui régnait mais ne gouvernait pas et n’avait pas d’articulations sociales solides. En Allemagne, les choses étaient différentes. Même après l'effondrement militaire et la révolution de 1918, et malgré le marasme social, il y avait encore des vestiges profondément enracinés dans ce monde hiérarchique, parfois encore féodal, centré sur les valeurs de l'État et de son autorité, faisant partie de la tradition précédente, en particulier du prussianisme. […]. En fait, en Europe centrale, les idées de la Révolution française n'ont jamais pris autant d'ampleur que dans les autres pays européens" .
Mais les différences, du point de vue de l’environnement, sont beaucoup plus marquées. Dans son essai sur le Troisième Reich, qui décrit les courants culturels complexes et souvent irréductibles qui ont coopéré à sa genèse, Evola écrit : "Après la Première Guerre mondiale, la situation en Allemagne était nettement différente de celle de l'Italie. [...] Mussolini a dû créer presque tout à partir de rien, en ce sens qu'au moment de combattre la subversion rouge et de remettre l'État sur pied, il ne pouvait pas se référer à une tradition au sens le plus élevé du terme. Tout bien considéré, ce qui était menacé n'était que l'extension de l'Italie démocratique du XIXe siècle, avec un héritage du Risorgimento influencé par les idéologies de la Révolution française, avec une monarchie qui régnait mais ne gouvernait pas et n’avait pas d’articulations sociales solides. En Allemagne, les choses étaient différentes. Même après l'effondrement militaire et la révolution de 1918, et malgré le marasme social, il y avait encore des vestiges profondément enracinés dans ce monde hiérarchique, parfois encore féodal, centré sur les valeurs de l'État et de son autorité, faisant partie de la tradition précédente, en particulier du prussianisme. […]. En fait, en Europe centrale, les idées de la Révolution française n'ont jamais pris autant d'ampleur que dans les autres pays européens" .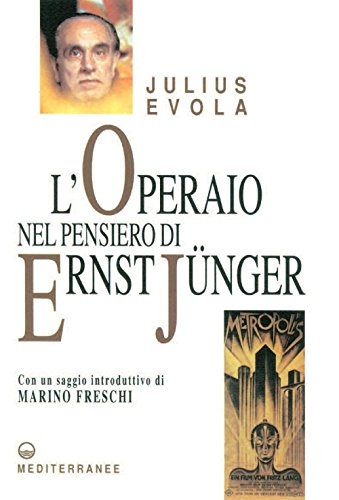 La même Allemagne de Frédéric II puis de Guillaume II, tout en conservant les structures et l'ordre d'un État traditionnel (Obrigkeitsstaat), dans lequel la même bureaucratie et le même appareil d'État apparaissaient presque comme les organes d'un ordre, contenait les germes de la dissolution, due aux idées des Lumières qui avaient commencé à filtrer - de façon plus subtile qu'ailleurs - dans les différentes instances. Si le jugement d'Evola sur le code de Frédéric, préservant l'ordre divisé en Stände est positif, c'est parce que, pour l'époque où il a été créé, ce code a mieux préservé que tout autre les structures féodales et hiérarchiques précédentes. Celles-ci, à travers la tradition prussienne, s'enracinent dans l'Ordre des Chevaliers Teutoniques et leur reconquête des terres baltes : un ordre ascético-chevaleresque formé par la discipline et une organisation hiérarchique stricte. Ainsi, dès son plus jeune âge, Evola pressent l'absurdité de la "guerre civile européenne" qu'il va devoir néanmoins mener, en tant que très jeune officier, à la frontière austro-italienne, celle du Karst : l'Italie prend parti contre ce qui reste de la meilleure tradition européenne. "En 1914, les Empires centraux représentaient encore un vestige de l'Europe féodale et aristocratique dans le monde occidental, malgré des aspects indéniables d'hégémonie militariste et quelques alliances suspectes avec le capitalisme présent surtout dans l'Allemagne wilhelminienne. La coalition contre eux était ouvertement une coalition du Troisième pouvoir contre les forces résiduelles du Deuxième pouvoir [...]. Comme peu d'autres dans l'histoire, la guerre de 1914-1918 présente toutes les caractéristiques d'un conflit non pas entre États et nations, mais entre les idéologies de différentes castes. Les résultats directs et attendus ont été la destruction de l'Allemagne monarchique et de l'Autriche catholique, les résultats indirects l'effondrement de l'empire du tsar, la révolution communiste et la création, en Europe, d'une situation politico-sociale si chaotique et contradictoire qu'elle contenait toutes les prémisses d'un nouvel embrasement. Et ce fut la Seconde Guerre mondiale" .
La même Allemagne de Frédéric II puis de Guillaume II, tout en conservant les structures et l'ordre d'un État traditionnel (Obrigkeitsstaat), dans lequel la même bureaucratie et le même appareil d'État apparaissaient presque comme les organes d'un ordre, contenait les germes de la dissolution, due aux idées des Lumières qui avaient commencé à filtrer - de façon plus subtile qu'ailleurs - dans les différentes instances. Si le jugement d'Evola sur le code de Frédéric, préservant l'ordre divisé en Stände est positif, c'est parce que, pour l'époque où il a été créé, ce code a mieux préservé que tout autre les structures féodales et hiérarchiques précédentes. Celles-ci, à travers la tradition prussienne, s'enracinent dans l'Ordre des Chevaliers Teutoniques et leur reconquête des terres baltes : un ordre ascético-chevaleresque formé par la discipline et une organisation hiérarchique stricte. Ainsi, dès son plus jeune âge, Evola pressent l'absurdité de la "guerre civile européenne" qu'il va devoir néanmoins mener, en tant que très jeune officier, à la frontière austro-italienne, celle du Karst : l'Italie prend parti contre ce qui reste de la meilleure tradition européenne. "En 1914, les Empires centraux représentaient encore un vestige de l'Europe féodale et aristocratique dans le monde occidental, malgré des aspects indéniables d'hégémonie militariste et quelques alliances suspectes avec le capitalisme présent surtout dans l'Allemagne wilhelminienne. La coalition contre eux était ouvertement une coalition du Troisième pouvoir contre les forces résiduelles du Deuxième pouvoir [...]. Comme peu d'autres dans l'histoire, la guerre de 1914-1918 présente toutes les caractéristiques d'un conflit non pas entre États et nations, mais entre les idéologies de différentes castes. Les résultats directs et attendus ont été la destruction de l'Allemagne monarchique et de l'Autriche catholique, les résultats indirects l'effondrement de l'empire du tsar, la révolution communiste et la création, en Europe, d'une situation politico-sociale si chaotique et contradictoire qu'elle contenait toutes les prémisses d'un nouvel embrasement. Et ce fut la Seconde Guerre mondiale" .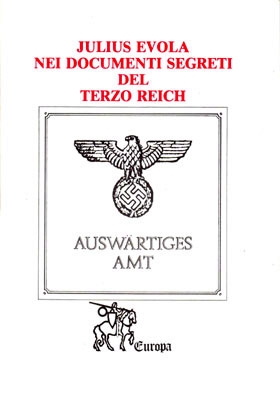 Dans cet humus historique des années de l'entre-deux-guerres, dans lequel les liens sentimentaux et éthiques de beaucoup avec la tradition impériale précédente étaient encore forts - la monarchie des Habsbourg d'Autriche avait au moins formellement conservé, jusqu'au Congrès de Vienne, la propriété du Saint Empire romain - Evola a également eu l'occasion de percevoir directement l'attachement populaire généralisé à la monarchie, et de l'expliquer en ces termes : "Sans exhumer des formes anachroniques, au lieu d'une propagande qui "humanise" le souverain pour captiver les masses, presque sur le modèle de la propagande américaine pour les élections présidentielles, il faut voir dans quelle mesure les traits d'une figure caractérisée par une certaine supériorité et dignité innées peuvent avoir une action profonde, dans un cadre approprié. Une sorte d'ascétisme et de liturgie du pouvoir pourrait jouer un rôle ici. Précisément ces traits, s'ils renforceront le prestige de celui qui incarne un symbole, devraient pouvoir exercer sur l'homme grossier une force d'attraction, voire une fierté à l'égard du sujet. En outre, même à une époque assez récente, nous avons eu l'exemple de l'empereur François-Joseph qui, tout en plaçant entre lui et ses sujets le vieux cérémonial sévère, sans pour autant imiter du tout les rois "démocratiques" des petits États du Nord, jouissait d'une popularité particulière, non vulgaire". Dans la même veine, en 1935, écrivant sur la possibilité d'une restauration impériale en Autriche, Evola rapporte ce que les représentants de la pensée conservatrice et monarchique dans ce pays préconisaient : "Le postulat, quant à lui, est celui auquel tout esprit non encombré de préjugés peut également adhérer, à savoir que le régime monarchique, en général, est celui qui peut le mieux garantir un ordre, un équilibre et une pacification intérieure, sans avoir à recourir au remède extrême de la dictature et de l'État centralisé, à condition qu'il subsiste chez les individus la sensibilité spirituelle requise par tout loyalisme. Cette condition, selon ces personnalités, serait présente dans la majeure partie de la population autrichienne, ne serait-ce que pour la force d'une tradition et d'un mode de vie pluriséculaire".
Dans cet humus historique des années de l'entre-deux-guerres, dans lequel les liens sentimentaux et éthiques de beaucoup avec la tradition impériale précédente étaient encore forts - la monarchie des Habsbourg d'Autriche avait au moins formellement conservé, jusqu'au Congrès de Vienne, la propriété du Saint Empire romain - Evola a également eu l'occasion de percevoir directement l'attachement populaire généralisé à la monarchie, et de l'expliquer en ces termes : "Sans exhumer des formes anachroniques, au lieu d'une propagande qui "humanise" le souverain pour captiver les masses, presque sur le modèle de la propagande américaine pour les élections présidentielles, il faut voir dans quelle mesure les traits d'une figure caractérisée par une certaine supériorité et dignité innées peuvent avoir une action profonde, dans un cadre approprié. Une sorte d'ascétisme et de liturgie du pouvoir pourrait jouer un rôle ici. Précisément ces traits, s'ils renforceront le prestige de celui qui incarne un symbole, devraient pouvoir exercer sur l'homme grossier une force d'attraction, voire une fierté à l'égard du sujet. En outre, même à une époque assez récente, nous avons eu l'exemple de l'empereur François-Joseph qui, tout en plaçant entre lui et ses sujets le vieux cérémonial sévère, sans pour autant imiter du tout les rois "démocratiques" des petits États du Nord, jouissait d'une popularité particulière, non vulgaire". Dans la même veine, en 1935, écrivant sur la possibilité d'une restauration impériale en Autriche, Evola rapporte ce que les représentants de la pensée conservatrice et monarchique dans ce pays préconisaient : "Le postulat, quant à lui, est celui auquel tout esprit non encombré de préjugés peut également adhérer, à savoir que le régime monarchique, en général, est celui qui peut le mieux garantir un ordre, un équilibre et une pacification intérieure, sans avoir à recourir au remède extrême de la dictature et de l'État centralisé, à condition qu'il subsiste chez les individus la sensibilité spirituelle requise par tout loyalisme. Cette condition, selon ces personnalités, serait présente dans la majeure partie de la population autrichienne, ne serait-ce que pour la force d'une tradition et d'un mode de vie pluriséculaire".
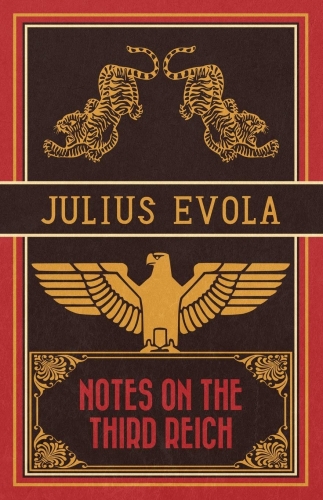
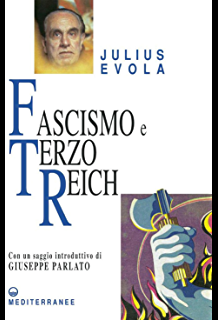 Même après la Seconde Guerre mondiale, Evola a gardé un œil sur les pays germanophones. Sa vision était celle d'une admiration pour la nouvelle résurrection économique opérée par les Allemands après être sortie du champs de ruines qu’elle était dans la seconde période de l'après-guerre ("cette nation a pu se relever complètement d'une destruction sans nom. Même sous l'occupation, elle a surpassé les nations victorieuses elles-mêmes sur le plan industriel et économique et a repris sa place de grande puissance productrice"). et pour le courage avec lequel la République fédérale avait banni le danger communiste de sa politique ("Les Allemands font toujours les choses avec cohérence. Donc aussi dans le jeu de la conformité démocratique. Ils ont mis en place une démocratie modèle comme un système "neutre" - nous dirions presque administratif, plutôt que politique - à la fois équilibré et énergique. Contrairement à l'Italie, l'Allemagne, précisément du point de vue d'une démocratie cohérente, a proscrit le communisme. La Cour constitutionnelle allemande a statué ce qui correspond à l'évidence même des choses, à savoir qu'un parti qui, comme le parti communiste, ne suit les règles démocratiques que dans une fonction purement tactique et de couverture, ayant pour objectif final déclaré la suppression de tout courant politique opposé et l’avènement de la dictature absolue du prolétariat, ne peut être toléré par un État démocratique qui ne veut pas creuser sa propre tombe") . Mais, malgré cela, la guerre avait alors produit un vide, un vide spirituel qui n'était plus comblé : "Contre tout cela, il est surprenant, en République fédérale, l'absence de toute idée, de tout "mythe", de toute vision supérieure du monde, de toute continuité avec l'Allemagne précédente". Toujours dans le domaine de la culture, Evola constate un glissement général, une sorte d'"échec" général aux positions courageuses et avant-gardistes des intellectuels allemands dans les années - selon Evola, très prospères et rentables sous le profil culturel - du Reich national-socialiste. Dans son jugement négatif, Evola prend comme exemple de cet effondrement Gottfried Benn et Ernst Jünger (tombant avec cela dans des erreurs de vue assez grossières).
Même après la Seconde Guerre mondiale, Evola a gardé un œil sur les pays germanophones. Sa vision était celle d'une admiration pour la nouvelle résurrection économique opérée par les Allemands après être sortie du champs de ruines qu’elle était dans la seconde période de l'après-guerre ("cette nation a pu se relever complètement d'une destruction sans nom. Même sous l'occupation, elle a surpassé les nations victorieuses elles-mêmes sur le plan industriel et économique et a repris sa place de grande puissance productrice"). et pour le courage avec lequel la République fédérale avait banni le danger communiste de sa politique ("Les Allemands font toujours les choses avec cohérence. Donc aussi dans le jeu de la conformité démocratique. Ils ont mis en place une démocratie modèle comme un système "neutre" - nous dirions presque administratif, plutôt que politique - à la fois équilibré et énergique. Contrairement à l'Italie, l'Allemagne, précisément du point de vue d'une démocratie cohérente, a proscrit le communisme. La Cour constitutionnelle allemande a statué ce qui correspond à l'évidence même des choses, à savoir qu'un parti qui, comme le parti communiste, ne suit les règles démocratiques que dans une fonction purement tactique et de couverture, ayant pour objectif final déclaré la suppression de tout courant politique opposé et l’avènement de la dictature absolue du prolétariat, ne peut être toléré par un État démocratique qui ne veut pas creuser sa propre tombe") . Mais, malgré cela, la guerre avait alors produit un vide, un vide spirituel qui n'était plus comblé : "Contre tout cela, il est surprenant, en République fédérale, l'absence de toute idée, de tout "mythe", de toute vision supérieure du monde, de toute continuité avec l'Allemagne précédente". Toujours dans le domaine de la culture, Evola constate un glissement général, une sorte d'"échec" général aux positions courageuses et avant-gardistes des intellectuels allemands dans les années - selon Evola, très prospères et rentables sous le profil culturel - du Reich national-socialiste. Dans son jugement négatif, Evola prend comme exemple de cet effondrement Gottfried Benn et Ernst Jünger (tombant avec cela dans des erreurs de vue assez grossières).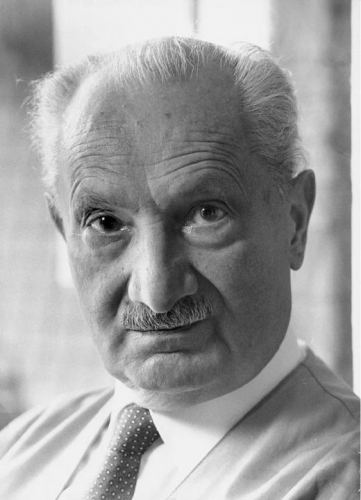

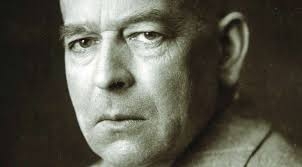
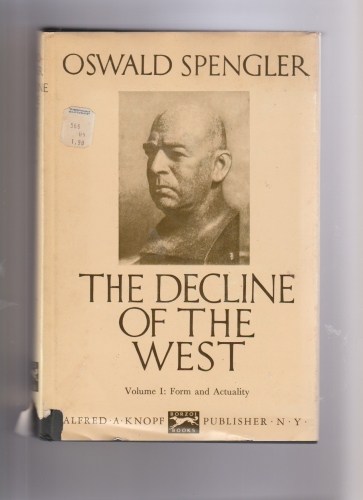
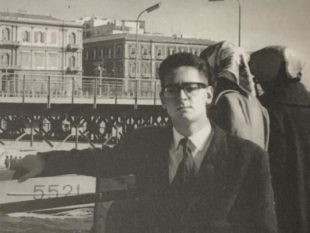
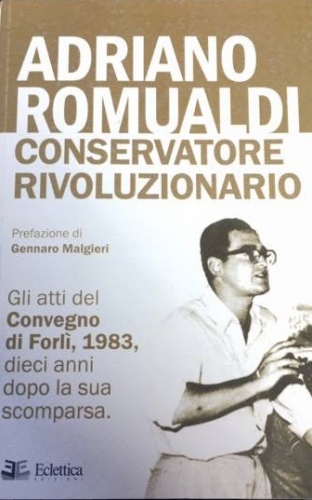 Il y a 80 ans, le 9 décembre 1940, Adriano Romualdi naissait à Forlì. Cet anniversaire est important pour se souvenir de cet intellectuel, demeuré jeune parce que décédé prématurément, le 12 août 1973, à la suite d'un accident de voiture. Son souvenir est resté gravé dans la mémoire de la jeune génération des années cinquante, confrontée à l'engagement politique et culturel des années soixante-dix. Adriano Romualdi était, pour cette génération, une sorte de grand frère, capable d'offrir à la vision néo-fasciste des raisons d'être plus profondes, puis d’emprunter de manière autonome les chemins d'un nouveau dynamisme culturel. Dans cette perspective, sa personnalité reste encore un exemple.
Il y a 80 ans, le 9 décembre 1940, Adriano Romualdi naissait à Forlì. Cet anniversaire est important pour se souvenir de cet intellectuel, demeuré jeune parce que décédé prématurément, le 12 août 1973, à la suite d'un accident de voiture. Son souvenir est resté gravé dans la mémoire de la jeune génération des années cinquante, confrontée à l'engagement politique et culturel des années soixante-dix. Adriano Romualdi était, pour cette génération, une sorte de grand frère, capable d'offrir à la vision néo-fasciste des raisons d'être plus profondes, puis d’emprunter de manière autonome les chemins d'un nouveau dynamisme culturel. Dans cette perspective, sa personnalité reste encore un exemple.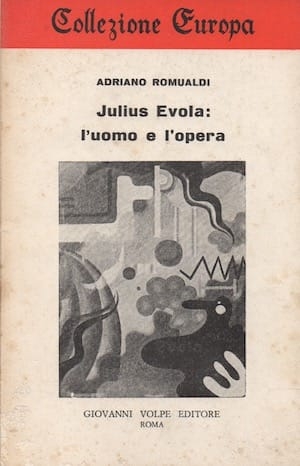 Son idée d'un droit politique "non égalitaire" repose sur ces solides fondements spirituels, que je viens d’exposer ici. C'est en septembre 1972 qu'Adriano Romualdi, à l'occasion de la conférence annuelle de la revue L'Italiano, dirigée par son père Pino, figure historique du MSI, met en évidence la distinction entre la droite (politique et culturelle) et le qualunquisme, sous ses différentes formes (qualunquisme politique, patriotique, culturel).
Son idée d'un droit politique "non égalitaire" repose sur ces solides fondements spirituels, que je viens d’exposer ici. C'est en septembre 1972 qu'Adriano Romualdi, à l'occasion de la conférence annuelle de la revue L'Italiano, dirigée par son père Pino, figure historique du MSI, met en évidence la distinction entre la droite (politique et culturelle) et le qualunquisme, sous ses différentes formes (qualunquisme politique, patriotique, culturel).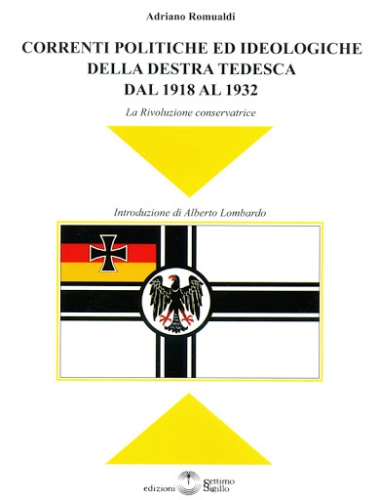 En dehors des contingences d'une situation politique et culturelle de cette époque d’avant 1973, qui sont nettement perceptibles dans certains passages de son œuvre écrite, inévitablement affectée par le temps qui a passé. Les bouleversements de notre époque ont changé la donne (il suffit de penser à la fin de l'URSS, à la crise de l'empire américain, à l'émergence de la mondialisation, à la montée des nouvelles économies asiatiques). Les propositions de Romualdi conservent leur valeur, dans la mesure où elles se nourrissent d'une vision profonde de la culture et donc de la politique, rejetant tout minimalisme et toute respectabilité rassurante.
En dehors des contingences d'une situation politique et culturelle de cette époque d’avant 1973, qui sont nettement perceptibles dans certains passages de son œuvre écrite, inévitablement affectée par le temps qui a passé. Les bouleversements de notre époque ont changé la donne (il suffit de penser à la fin de l'URSS, à la crise de l'empire américain, à l'émergence de la mondialisation, à la montée des nouvelles économies asiatiques). Les propositions de Romualdi conservent leur valeur, dans la mesure où elles se nourrissent d'une vision profonde de la culture et donc de la politique, rejetant tout minimalisme et toute respectabilité rassurante.